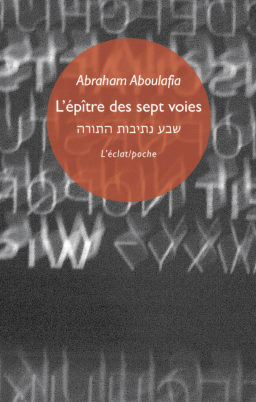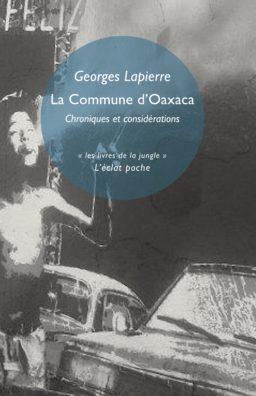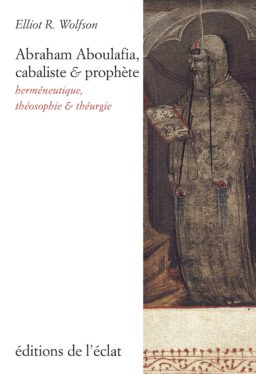Si la littérature sur Stanley Cavell est relativement abondante aux Etats-Unis, elle se réduit en France à un petit nombre d’articles.[1] et à de rares comptes-rendus. Certes, quelques auteurs hexagonaux le citent désormais, mais ils appartiennent généralement à des « tribus » différentes et mêmes adverses; aussi Stanley Cavell se retrouve-t-il, de fait, parmi les “inclassables” ou les “incasables”, à tel point qu’un récent volume d’ensemble sur la philosophie anglo-saxonne[2] semble avoir oublié jusqu’à son existence. Mon intention, ici, n’est pas de proposer une terre pour Stanley Cavell afin qu’il y installe sa tribu (et tel n’a jamais été non plus son propos, lui qui sait bien que la “tribu des sans-terre” est aussi sans désarroi devant l’absence de terre, puisqu’elle «habite son (propre) nom» et «bâtit sa (propre) demeure»). Je souhaiterai simplement indiquer une dimension paradoxale de l’œuvre de Stanley Cavell qui, du moins à ma connaissance, n’a fait l’objet d’aucune signalisation jusqu’à présent[3], et qui pourrait toutefois permettre de le mieux comprendre.
Si la littérature sur Stanley Cavell est relativement abondante aux Etats-Unis, elle se réduit en France à un petit nombre d’articles.[1] et à de rares comptes-rendus. Certes, quelques auteurs hexagonaux le citent désormais, mais ils appartiennent généralement à des « tribus » différentes et mêmes adverses; aussi Stanley Cavell se retrouve-t-il, de fait, parmi les “inclassables” ou les “incasables”, à tel point qu’un récent volume d’ensemble sur la philosophie anglo-saxonne[2] semble avoir oublié jusqu’à son existence. Mon intention, ici, n’est pas de proposer une terre pour Stanley Cavell afin qu’il y installe sa tribu (et tel n’a jamais été non plus son propos, lui qui sait bien que la “tribu des sans-terre” est aussi sans désarroi devant l’absence de terre, puisqu’elle «habite son (propre) nom» et «bâtit sa (propre) demeure»). Je souhaiterai simplement indiquer une dimension paradoxale de l’œuvre de Stanley Cavell qui, du moins à ma connaissance, n’a fait l’objet d’aucune signalisation jusqu’à présent[3], et qui pourrait toutefois permettre de le mieux comprendre.
Le problème – l’énigme –, posé par Cavell dans ce que l’on pourrait appeler sa trilogie émersonienne[4], porte sur la question de l’héritage. C’est aussi une question qui traverse l’œuvre tout entière de Cavell, et ses démarches vers Shakespeare, vers le cinéma américain, vers une certaine idée du scepticisme consistent, pour une part, à tenter de constituer une loi première pour un monde qui naît après la loi ; un monde qui naît après que la loi a bel et bien été donnée. Tenter de reconstituer la loi éparse, préalable, qui sous-tend ce monde. Son Monde. Le “Nouveau” Monde.
On connaît cette histoire juive qui met en scène un juif et un non-juif ; le non-juif dit : «Pourquoi, vous les juifs, répondez-vous toujours aux questions par des questions?» Ce à quoi le juif répond: «Oui, en effet pourquoi?» Fidèle en cela à ses pères, Cavell répond aux questions par des questions, et ne se contente jamais d’une réponse. Ainsi à la question : «Y a-t-il un héritage philosophique pour le continent américain?» Il répond, fidèle aussi en cela à ses origines analytiques[5]: «Qu’est-ce que c’est qu’un héritage?»; «Qu’est-ce que c’est qu’un héritage philosophique?»; «Qu’est-ce que c’est qu’un continent?»; «Qu’est-ce que c’est “américain”?» Et c’est cet ensemble de questions imbriquées qui peut donner, sinon des éléments de réponse, du moins des éléments de … questions nouvelles !
Un peu à l’image du Moïse du Deutéronome – on excusera la comparaison –, il montre la voie par son questionnement mais se garde bien de pénétrer dans la terre promise de la réponse. Libre à ceux qui s’y établissent d’y voir une destination, d’y trouver leur fin, et de s’y rassasier. Cavell, par son écriture, reste en dehors. Parce que l’écriture philosophique de Cavell a tordu le cou à toutes les ponctuations qui voudraient la contenir dans quelque carcan institutionnel ou rhétorique que ce soit. Elle dessine un territoire aux frontières mouvantes. La phrase de Cavell est comme le poids de Michelstaedter[6] qui sait qu’il doit toujours pendre pour demeurer ce qu’il est, et ne jamais dépendre, ne jamais s’arrêter de pendre et de peser pour continuer d’être un poids. La phrase de Cavell est sans fin. Elle est persuadée.
Mais si, incidemment, j’ai évoqué Moïse et le Deutéronome, c’est parce qu’à mon avis, le secret (ou une part du secret) de Stanley Cavell se trouve dans leur entourage.
Le Deutéronome c’est le livre de l’héritage. Le livre de la constitution d’une loi, de la constitution d’une nation et de la constitution d’une terre. En hébreu, le Deutéronome est appelé Dévarim, c’est-à-dire les «mots » et aussi les « choses », et le Deutéronome c’est, à ce titre, le livre de l’héritage qui est constitué par les mots et les choses en tant qu’ils fondent une loi, une nation et une terre – c’est pourquoi il est dit dans le Talmud au traité Sanhédrin : «Quiconque s’abstient d’enseigner une halakha – c’est-à-dire le cheminement de l’esprit (du verbe halakh : marcher) qui mènent aux conclusions d’une loi – quiconque s’abstient d’enseigner une halakha à un élève, dis-je, c’est comme s’il lui volait quelque chose de l’héritage de ses ancêtres». Et c’est, d’une certaine manière ce cheminement de l’esprit qui mènent aux conclusions d’une loi, à la constitution d’une nation par la loi, que nous enseigne Cavell quand il désigne les différents ancêtres de cette loi, les différents Moïse du Nouveau Monde.
Mais, à Devarim, les traducteurs de la Septante ont préféré Deutèronomos, c’est-à-dire, étymologiquement, la «seconde loi», qui conclut le Pentateuque. Il n’est pas inutile d’insister sur ce titre grec de Devarim. «Seconde loi » suppose, même pour le piètre logicien que je suis, une première loi, qui pourrait être la loi première, englobante, celle du Berechit – Commencement – de la Genèse, qui ouvre précisément le Pentateuque; la loi non énoncée, ou plutôt la loi qui n’a pas besoin d’être énoncée pour être, la loi qui ne nécessite pas de cheminement, puisqu’elle se trouve au commencement du chemin. Je fais l’hypothèse que cette loi trouve son expression dans la haggadah, c’est-à-dire l’autre grand courant de la littérature talmudique, et qui recouvre tout ce qui a trait au récit, «tout ce qui parle directement au cœur pour le toucher, à l’esprit pour le persuader ». Le Dire par excellence, c’est-à-dire la légende, l’histoire, l’anecdote, le rêve. Et c’est une dimension que l’on retrouve aussi, mêlée à la première, dans l’écriture de Cavell, qui est récit et philosophie, qui est une philosophie du Dire, une écriture ou une littérature philosophique inouïe à mon sens.
On peut se demander pourquoi a-t-on jugé qu’il était nécessaire, après la première loi, d’établir une seconde loi. Et pourquoi cette nécessité s’affirme-t-elle justement au chapitre qui concerne le don de la terre, la fondation de la Nation. A la loi première du Béréchit, du Commencement, qui fonde l’individu et qui s’exprime dans le Dire, fait suite la seconde loi qui fonde la Nation – le multiple en tant qu’un –, qui la constitue et qui est destinée exclusivement à la société des hommes[7].
Il y a toutefois un événement de toute première importance dans la fondation de cette nation: une fois de plus, celui qui la fonde s’en retire. On sait qu’une fois le monde créé, YHVH se retire dans l’exil. Il est en deçà du commencement du Monde. De même, Moïse ne pénètre pas en terre promise et reste attaché à sa situation d’exilé éternel. La terre promise est donnée en héritage au peuple hébreu, en même temps que sa seconde loi, mais ni celui qui donne la loi, ni celui qui donne la Nation ne font partie de ce monde. Ils se retirent. Ainsi le peuple à qui cette terre et cette loi ont été données, se retrouve orphelin dès sa naissance en tant que nation, dès lors qu’il accède à la propriété.
Toutes proportions gardées, et sur cette seule question du rapport à l’héritage – du moins en ce qui nous concerne –, le sort du peuple d’exilés devenu la Nation américaine n’est pas sans rappeler le sort du peuple d’exilés devenu la Nation juive. En même temps qu’elles sont produites l’une et l’autre, c’est-à-dire conduites vers leur lieu, elles se retrouvent orphelines de celui qui détient la clef de leur héritage, de leur filiation. D’où leurs errements et égarements respectifs qui dureront bien plus longtemps que les quarante années dans le désert. Et qui, d’une certaine manière, durent toujours.
Celui qui fonde et, donc, constitue un héritage pour les générations futures, est un exilé. Ce n’est que depuis l’exil que l’on peut fonder une nation. C’est donc depuis l’exil que l’on peut fonder ce qui constitue une nation, c’est-à-dire une pensée propre. Mais que devient la part d’exil d’une Nation qui a désormais sa loi et sa terre? C’est cette part d’exil qui constitue la première loi d’une Nation qui a désormais sa terre. Et c’est cette part d’exil qui est cachée par la seconde loi, qui est cachée sous la constitution.
Dès lors, quel est l’héritage de la pensée américaine, et quel héritage peut-elle revendiquer? Il se peut que ce soit Emerson qui soit le fondateur de la philosophie américaine, en tant qu’il la constitue. Mais il se peut aussi que ce soit Cavell qui permette à Emerson de fonder la philosophie américaine. Il se peut que ce soit Cavell qui permette à la nation américaine de trouver en Emerson son fondateur, son Josué et non plus son Moïse. Parce que lui-même, Cavell, appartient l’exil. Parce que Cavell, à mes yeux, a ce statut particulier d’exilé de la philosophie et dans la philosophie, parce qu’il refuse de se contenter de la terre promise, parce qu’il sait que toute promesse se doit d’être toujours à venir, parce qu’il sait que lorsque vient la question de l’héritage, les vautours ne manquent jamais de réclamer leur part, et qu’il faut mieux alors prétendre que le partage a déjà eu lieu, qu’il n’y a rien à rogner sur les os du père fondateur, et que chacun devra, seulement s’il en est capable, allumer une lumière pour lui-même, selon la formule décisive d’Héraclite.
Autre problème. Il est dit ailleurs dans le Talmud, au traité Baba Bathra, que c’est Moïse qui aurait dû prendre l’initiative d’écrire le chapitre qui traite des droits de succession, et qu’il ne l’a pas fait. C’est donc à cause de ceux qui ont transgressé la loi des droits de succession que ce chapitre fut écrit; ainsi les bienfaits de la loi arrivent par l’intermédiaire des gens de mérite et les châtiments de la loi par l’intermédiaire de coupables.
Cavell, par une sorte de générosité – qui est le fondement de sa philosophie – nous dit que le «chapitre des droits de succession» a été écrit par Emerson et Thoreau. Qu’à partir de leur œuvre on peut établir les différentes filiations de la pensée américaine. Mais il n’est pas sûr que ce soit le cas. Il n’est pas sûr que ce ne soit pas lui qui ait écrit, pour eux[8], le chapitre qui traite des droits de succession, et leur cède la place pour éviter que ce ne soient ceux qui pourraient transgresser cette loi qui l’écrivent à leur place. De même qu’il n’est pas sûr que Cavell soit seulement l’héritier de Walden ou la vie dans les bois, mais peut-être est-il aussi l’héritier du Deutéronome? Il n’est pas sûr que Cavell soit seulement l’héritier de Fate mais peut-être est-il aussi l’héritier de Devarim? Il n’est pas sûr que la phrase infinie de Stanley Cavell ait sa source dans la seule prose poétique et quelquefois ampoulée de Nature, mais peut-être a-t-elle aussi sa source dans l’infini embrouillamini des maîtres du Talmud des troisième et quatrième siècles.
Michel Valensi
* Ce court texte est une version légèrement modifiée, puis annotée, d’une intervention à L’ENS, en juin 1993, à l’occasion d’une journée d’études à l’initiative de Claude Imbert, consacrée à Stanley Cavell. Il aborde l’œuvre de Cavell dans une perspective déjà particulière et fait l’économie d’une présentation d’ensemble. Pour plus de précision sur les problématiques évoquées dans ces pages, il suffira simplement au lecteur de “lire” ou d’“écouter” Cavell.
[1]. La situation a bien changé aujourd’hui où l’œuvre de Cavell, découverte en France à l’occasion des livres que Jean-Pierre Cometti a fait paraître dans sa collection « tiré à part », dès 1991, fait l’objet d’un culte dans les milieux les plus divers. En témoignent les nombreux hommages récents et les publications éparpillées chez plusieurs éditeurs.
[2]. La philosophie anglo-saxonne, sous la direction de Michel Meyer, PUF, Paris, 1994.
[3]. A l’exception de Giovanna Borradori, Conversazioni americane, Laterza, Bari, 1991, qui à la fin de son entretien avec Stanley Cavell, fait allusion à cette “dimension paradoxale”, sans pour autant la développer.
[4] Soit: Une nouvelle Amérique encore inapprochable. De Wittgenstein à Emerson (1989) (tr. fr. S. Laugier, L’éclat, Combas, 1991); Statuts d’Emerson. Constitution, Philosophie, Politique (inédit en anglais) (tr. fr. S. Laugier, C. Fournier, L’éclat, Combas, 1992); Conditions nobles et ignobles. La constitution du perfectionnisme émersonien (1992) (tr. fr. S. Laugier et C. Fournier, L’éclat, Combas, 1993), auxquels il faudrait ajouter les appendices de Senses of Walden (5ème édition, Chicago U. P. Chicago, 1992) consacrés à Emerson.
[5]. La fidélité à cet héritage ne semble pas perçue en France, où son œuvre est reçue de manière pour le moins “réservée” par la « tribu » néo-analytique. La France est désormais presque tout entière tournée vers une version de la philosophie analytique anglo-saxonne. Ce tournant s’effectue après de longues années au cours desquelles cette même France était tout entière tournée vers une certaine version (heideggérienne pour l’essentiel) du nietzschéisme – années noires pour les nouveaux maîtres à penser de la philosophie – comme le deviendront sans doute celles à venir pour les anciens qui auront survécu aux guerres tribales institutionnelles. Il semble que ce soit désormais le propre de la France de ne jamais rien voir de ce qui est vivant, pour ne jamais adorer que des dieux morts. Au Dionysos-enfant – turbulent et problématique – (qu’aurait pu constituer le questionnement analytique à son surgissement), elle préférera toujours le cadavre lacéré par les Ménades du même Dionysos – gisant et inoffensif –, espérant quelque résurrection hypothétique, tout en pouvant, dans l’attente, se repaître de cette chair fraîchement sortie des abattoirs – parce qu’elle ne voudra jamais non plus porter la main au couteau, et préférera voir proliférer les bouchers, jusqu’à devenir elle-même peuple entier de bouchers philosophes – ce qui s’annonce! [Cette note, élaguée, date. Elle visait un compte-rendu très critique des traductions françaises de Cavell que nous venions de faire paraître. Le temps a passé, la colère aussi.]
[6]. Cf. les premières pages de La persuasion et la rhétorique, tr. fr. L’éclat, Combas 1989. L’évocation, dans ces quelques pages, de l’œuvre de Michelstaedter n’est pas fortuite; nombre d’interrogations qui sont au cœur de l’œuvre de Cavell trouvent un écho dans l’œuvre michelstaedterienne. Mais cette question mériterait sans doute un traitement séparé.
[7]. C’est aussi ce qui revient, sous une autre forme, dans le récit de la remise des tables à Moïse: une première fois taillées et gravées par YHVH, puis brisées par Moïse qui voit son peuple adorer le Veau d’or; une seconde fois écrites par Moïse lui-même («Écris pour toi ces paroles», Ex. 34,27).
[8]. C’est une idée qu’a également développée Arnold Davidson dans son intervention à cette journée d’études sur Cavell à l’Ens.