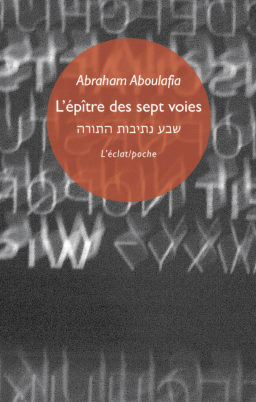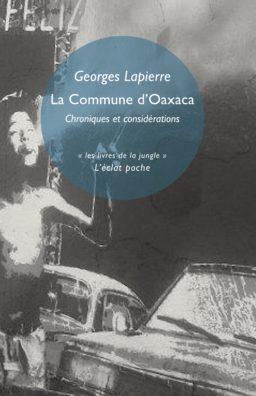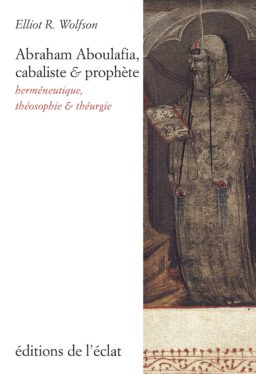(photo Marianne Polonsky)
Yona Friedman est parti. Peut-être a-t-il rejoint les villes suspendues qu’il a imaginées? Elles sont là sur le papier laissé sur sa table. Il est inconcevable d’imaginer cet appartement sans lui. Sans lui près de sa table. Il y dessinait des lieux d’habitations, il y inventait aussi des formes pour nous donner envie d’inventer des formes. Les nôtres. Autour de cette table, sur les murs et sur le sol, le monde qui s’inventait derrière ses yeux avait poussé comme les plantes dans une serre. Rien de grandiloquent, rien. Yona Friedman avait son alphabet et son bestiaire. Et ses étranges bandes dessinées philosophiques. Dans ce monde, qu’il inventait pour nous, les humains, nous sommes des petits bâtons d’encre, des silhouettes mi-phasmes mi-chiens. Mais ce que nous disons est d’une extrême importance. Pourquoi est-ce si important vous demanderez-vous ? Comment des petits signes d’encre, dans un décor réduit à quelques autres bâtonnets d’encre peuvent-ils être si importants ? Mais parce qu’ils parlent la langue de ce monde-là. Un monde sans argent et sans arrogance. Sans surplus et sans avidité. Rappelez-vous, c’était juste au siècle dernier. On en parlait, on l’imaginait, certains essayaient d’en dessiner les contours ou de lui donner un langage, un imaginaire, des faunes et des flores. Des choses respirables. Déjà le monde plein d’animaux et d’arbres qui avait existé commençait à reculer dans un lointain passé. Yona Friedman faisait partie de ceux qui allaient dans ce passé pour en tirer des choses vivantes. Pas des images et des mots seulement, des formes, des couleurs, des pelages, des peaux. Du vivant. A quoi bon dénoncer, rendre compte, faire des constats ? C’est d’un monde vivable dont nous avons besoin. Et c’est ça que Yona dessinait sur cette table dans cet appartement parisien. Du vivable.
Du soldat allemand qui ne lui a pas tiré une balle dans la tête en 1945 il ne parlait pas, ni de tous ses exils, ni de toutes ces langues qu’il avait dû apprendre et qu’il parlait toutes avec l’accent hongrois. De la perte des proches que sa longue vie avait laissés sur le chemin, il ne disait rien. Peut-être à ce moment s’enfonçait-il plus profondément dans sa surdité. Par contre, il énonçait ses idées pleines de sens et de vivacité, intelligentes, astucieuses, bienveillantes, comme ça, mine de rien, tout en caressant la tête de sa chienne Balkis et en souriant à Denise. Impossible de parler de Yona sans évoquer Denise. Ces deux-là s’étaient trouvés. Dans les méandres des foules humaines, il arrive parfois que deux spécimens se rapprochent et qu’ils soient fait pour s’entendre. Et ces deux-là s’entendaient à merveille. Elle est partie avant lui, Denise. Puis Balkis est partie. Et l’appartement est devenu plus silencieux, il restait la longue silhouette d’un homme sans âge qui continuait à tracer ses formes, ses géométries, ses phasmes. Quelques semaines avant son départ, nous avons reçu ses derniers signes écrits, quelques dessins récents à ajouter à L’architecture mobile, commencé en 1958 et dont nous préparions une nouvelle édition complète pour le mois de mai 2020 et dont il venait de recevoir les épreuves.
Il n’était pas question pour lui de revenir sur ce qu’il avait écrit ou dessiné sans y ajouter quelque chose, y revenir, le tordre, le penser, le repenser, à l’image de ses « space chains » qu’il aimait tant faire ici et là de par le monde, où le commencement est la fin et la fin est le commencement, et où venaient se loger l’immédiateté permanente et la joie généreuse de la création collective de mondes. « Rien. Puis, ensemble, quelque chose ». C’est la magie de Yona, grand lecteur de Leibniz (dont il avait illustré la Monadologie), de faire quelque chose à partir de rien et de voir ce quelque chose devenir « la vie même ». La vie qu’il laisse aujourd’hui et nous laisse et nous confie, à nous autres humains qui restons bien seuls désormais, avec la tâche de continuer sans lui et du mieux possible son œuvre de paix, lui qui était Fried-man entre tous, bâtisseur d’utopies, qu’il nous faut, à notre tour, réaliser et animer, ou plutôt, dans son vocabulaire, animaler, parce qu’il croyait plus à l’animal qu’à l’âme. Mais qu’importe ! Que la sienne, en tout cas, vienne s’envelopper dans l’enveloppe des vivants. ת נ צ ב ח