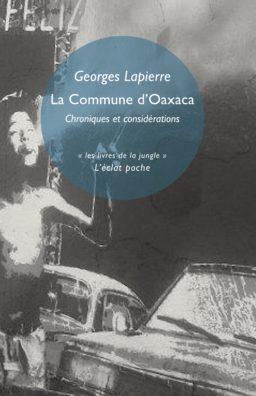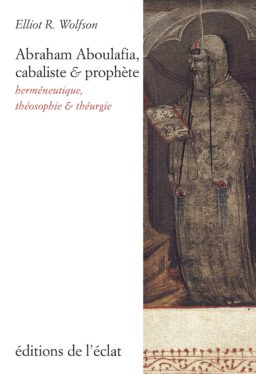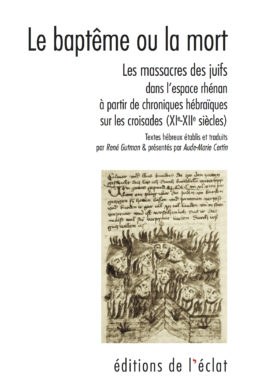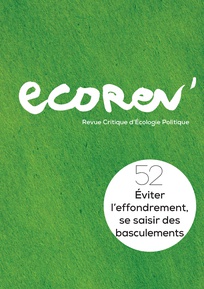 Compte rendu par Françoise Golain du livre de Francesco Brancaccio, Alfonso Giuliani, Carlo Vercellone, Le commun comme mode de production, Éd. de l’Éclat, 2021, 360 p.paru dans EcoRev’ 2022/1 (N° 52)
Compte rendu par Françoise Golain du livre de Francesco Brancaccio, Alfonso Giuliani, Carlo Vercellone, Le commun comme mode de production, Éd. de l’Éclat, 2021, 360 p.paru dans EcoRev’ 2022/1 (N° 52)
Dense mais toujours abordable grâce à une écriture précise et élégante, ce livre met tout d’abord en perspective différentes approches théoriques des biens communs, puis dégage ce que les auteurs considèrent comme les enjeux et possibilités émancipatrices de la résurgence de la thématique du « commun » au cours de ces dernières années.
Communs fonciers, Commune de Paris, mouvements de coopératives, etc. : même si elles demeurent minoritaires historiquement, une diversité de pratiques passées et contemporaines permet de contester le paradigme d’une économie organisée autour de la polarité public-privé, comme l’a établi, de l’intérieur du paradigme néoclassique, Elinor Ostrom. Critiques cependant de sa représentation atomistique de la société, les auteurs vont plus loin – et c’est l’un des intérêts de l’ouvrage : ils réinvestissent la problématique du communisme en abordant en termes nouveaux la fameuse « réappropriation des moyens de production », disqualifiée par les expériences du « socialisme réel » et sa fausse propriété collective.
Pour ce faire, les trois contributeurs se livrent à une réélaboration du concept de travail immatériel conçu dans la seconde moitié des années 1990 par le courant néo-opéraïste dans lequel ils s’inscrivent. On peut en rendre compte brièvement ainsi : suite à la crise du modèle fordiste, a émergé une économie dans laquelle la connaissance joue un rôle moteur, indissociable de la révolution informationnelle. Les dimensions cognitives, immatérielles et relationnelles du travail sont désormais centrales à la fois sur le plan de la création de la plus-value et de la richesse non marchande. Or, ces mutations, ouvrant la possibilité d’un renouveau du projet autogestionnaire, expliquent précisément le retour en force de la dynamique des biens communs dans le capitalisme contemporain. Car, selon les auteurs, tous reposent sur la mobilisation de savoirs complexes et l’enrichissement des savoir-faire par la pratique. Récusant une définition naturaliste des communs en termes de caractéristiques intrinsèques, ils invitent donc à prendre en considération l’activité humaine qui en assure la production et la reproduction. En conséquence, ils prennent une distance explicite d’avec la conception principalement politique et juridique de Pierre Dardot et Christian Laval dont l’ouvrage (Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle, Paris, La Découverte, 2014) demeure une référence sur le sujet.
Le commun, employé au singulier car envisagé comme véritable mode de production, résulte en effet d’une construction sociale permanente fondée sur la diffusion de la connaissance et l’autogouvernance de la production. C’est la raison pour laquelle il rassemble, dans leur diversité, les différentes catégories de communs. Ses principes d’organisation peuvent potentiellement concerner tous types de ressources, de biens et d’activités, matérielles ou immatérielles ; qu’il s’agisse de logiciels, de « productions de l’humain par l’humain » (santé, éducation, travail du care), de l’agriculture ou de l’entretien des espaces naturels.
Optimiste, audacieuse même, la thèse avancée ici est que le commun contient en son sein les conditions d’un dépassement du capitalisme et qu’il est susceptible de disputer l’hégémonie aux logiques étatique et marchande en tant que principe de coordination de la production et des échanges.
Notons que cette promesse des communs – traditionnels ou numériques – repose sur le présupposé philosophique d’une autonomie du travail vivant et, en l’occurrence, de « la coopération d’une intelligence collective » par rapport à l’organisation capitaliste de la production. Ce positionnement dans la tradition opéraïste implique une définition relativement extensive du travail qui diverge d’avec celles des théories marxistes classiques de l’exploitation, comme de celle du courant contemporain de la Critique de la valeur pour lequel le travail vivant n’est que le support du travail abstrait, décrit par Marx, qui participe du processus d’accumulation de capital.
Tandis qu’André Gorz s’est montré proche de ce dernier courant dans lequel il trouvait une analyse pertinente de la dynamique du capital, il portait également attention à l’émergence et à l’expression de subjectivités autonomes, rebelles. Ce livre fait donc naturellement référence à ses Misères du présent, richesse du possible (Paris, Galilée, 1997) comme au travail de facture philosophique de Michael Hardt et Toni Negri, Commonwealth (Paris, Stock, 2012). Pour sa part, et afin d’établir qu’il ne s’agit pas d’une utopie, il s’attache à dégager à partir d’expériences concrètes la double logique qui préside aux divers communs : l’inappropriabilité des outils de production associée à la mutualisation des ressources d’une part, l’autogestion de l’organisation du travail de l’autre.
L’un des chapitres examine notamment la réflexion menée en Italie sur une refonte des régimes juridiques mis en œuvre pour protéger les différents communs. Cette réflexion a été étroitement liée à la création de communs urbains en résistance à la rente foncière et aux politiques prédatrices de spéculation immobilière. Or, l’administration devrait être reconfigurée comme simple mandataire et non plus comme propriétaire des biens et des ressources gérées collectivement. L’un des axes mis en avant par les contributeurs consisterait à substituer au modèle du Welfare celui d’un Commonfare résidant dans le développement de formes démocratiques et inédites d’autogestion de la production qui impliquerait étroitement les usagers et les territoires – sont considérés à ce titre le secteur de la santé ainsi que les communs fonciers et écologiques.
Une part significative du livre est par ailleurs consacrée à une investigation fouillée d’une autre incarnation de la logique du commun, en opposition frontale à la logique propriétaire du capitalisme cognitif et informationnel : les communs numériques.
On assiste depuis les années 1980 à un retour d’une logique de la rente qui explique le poids croissant de la finance et la privatisation des services collectifs ainsi qu’un renforcement des droits de propriété intellectuelle. Le développement des communs numériques ne constitue pas exclusivement une réponse à ce processus. Il a été précédé en ce domaine par des pratiques de coopération et d’échanges des savoirs qui ont été décisives pour les grandes innovations à l’origine du déclenchement de la révolution informationnelle et de la conception de l’Internet. Le caractère ouvert des technologies de l’information – Wikipedia, logiciels libres, régimes juridiques du copyleft et des Creative Commons – a été le produit d’une construction sociale du commun de la part des communautés de la contre-culture hippie et hacker, porteuses d’une éthique libertaire et démocratique des savoirs ouverts. Leur auto-organisation du travail se révélant souvent plus performante que le modèle propriétaire, le capitalisme cognitif s’est alors essentiellement borné à entraver la circulation des connaissances. Il y a, en d’autres termes, expropriation d’une richesse commune par le capital selon une logique extractiviste et de surveillance (pensons à nos traces sur Internet).
L’ubérisation de l’économie a suscité un mouvement de résistance à la précarisation du travail qui est aussi examiné sous la double figure du coopérativisme de plateforme et du mouvement Maker, avec ses FabLabs et tiers-lieu de production, qui renouvellent la tradition du mouvement coopératif. Cette « formidable effervescence créative » investie dans une production horizontale et diffuse, proche de l’« artisanat hightech » cher à Gorz, nous est relatée avec enthousiasme.
En résumé, nous sommes, dans tous ces cas de figure, en présence d’une « contradiction entre une logique de la valeur, fondée sur la création de la rareté, et une logique de la richesse, fondée elle, sur l’abondance et la libre mise à disposition de la société d’un ensemble de valeurs d’usages sociales et de connaissances théoriques et techniques nourrissant les cercles vertueux de l’innovation collective » (p. 197).
La conclusion du livre esquisse alors les conditions essentielles devant être remplies pour que cette économie fondée sur la connaissance s’émancipe du capitalisme cognitif : d’une part, une diffusion des principes de la propriété commune et le dépassement de la propriété intellectuelle exclusive ; de l’autre, l’adoption de règles d’émission monétaire adéquates – notamment ce que les auteurs nomment « une monnaie du commun » – ainsi que l’octroi d’un revenu social garanti. Entendu comme un revenu primaire (et non redistributif) et comme une institution du commun, ce revenu validerait financièrement (et socialement) l’activité créatrice de richesse réalisée en son sein ; ceci notamment afin de pallier une faiblesse indiquée comme majeure : le modèle du logiciel libre étant presque exclusivement fondé sur un travail bénévole, la communauté des programmateurs fait inévitablement l’expérience de la contrainte au rapport salarial. Elle voit ses projets vulnérables aux dispositifs de capture mis en place par les plateformes capitalistes et les communs numériques demeurent relégués dans une position extrêmement minoritaire.
Massifier ces usages exigerait alors un modèle fédératif reposant sur la création d’un réseau de solidarité entre toutes les coopératives, anciennes et nouvelles, et l’extension d’un réseau d’ateliers autogérés qui fonctionneraient hors logique marchande. Ceux-ci pourraient mettre à disposition localement une gamme d’outils matériels et numériques destinés à une production « autonome [d’]une grande partie du nécessaire, et même du superflu, en nous émancipant du monopole absolu de l’État et du marché » (p. 301). En d’autres termes, gorziens encore : une réappropriation collective des moyens de production autorisant la nécessaire réorientation écologique avec relocalisation de la production et de la consommation, de manière à surmonter la séparation radicale entre le producteur et du consommateur.
À ce propos, il est plusieurs fois rappelé que le caractère intangible, immatériel de l’économie numérique ne saurait faire oublier sa prédation des ressources naturelles non renouvelables exigée par l’impératif productiviste consubstantiel au système. Quelques jalons concernant les contraintes spécifiques de rareté qui s’appliqueraient à ce domaine comme aux autres, dans le cadre d’une économie de l’abondance auraient alors été bienvenus. L’appel à un modèle de démocratie autogestionnaire et écologique où seraient prises « des décisions stratégiques portant sur les questions essentielles : comment produire ? que produire ? pour satisfaire quels besoins ? » (p. 64) implique logiquement, à mon sens, d’amorcer le débat sur les modalités de restauration d’une norme du suffisant.
De manière plus générale, alors que l’ouvrage est d’une grande richesse, on peut regretter que les indications programmatiques n’aient été abordées qu’en trop peu de pages de conclusion. Pourtant, elles auraient justifié une section ou au moins un chapitre entier puisqu’elles concernent véritablement les conditions concrètes de la construction d’une société fondée sur une véritable « démocratie du commun », voie envisagée d’une sortie civilisée du capitalisme. Y aura-t-il peut-être une suite ?