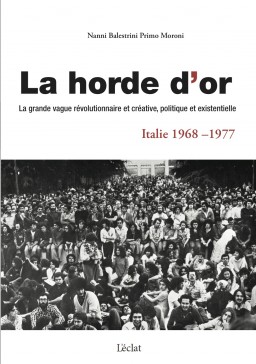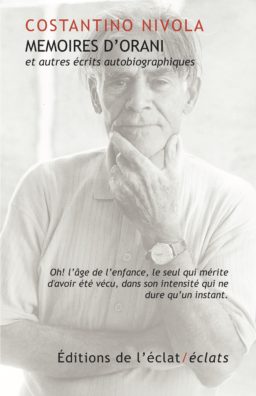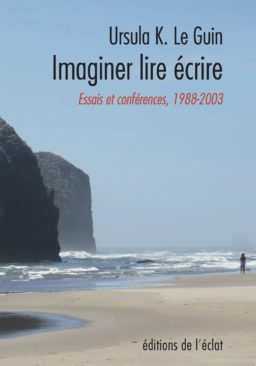Marie-José Minassian
À l’occasion de la nouvelle édition dans L’éclat/poche de La souveraineté du bien d’Iris Murdoch, traduit par Claude Pichevin, nous republions ici un entretien d’Iris Murdoch avec Marie José Minassian (que nous remercions), paru dans L’Âne. Le magazine freudien, avril-juin 1991, n°46, p. 14-15, dirigée alors par Judith Miller.
Lors de cette rencontre avec Iris Murdoch, c’est à la philosophe que Marie-José Minassian s’adressait. La romancière, si elle a pris le pas sur la philosophe, lui a volontiers cédé la place le temps de cet entretien: en effet, c’est un constat d’échec qu’elle dresse ici, celui de la philosophie universitaire, en particulier à Oxford, à considérer la lourde réalité de l’action humaine ou, comme l’écrit John Sturrock, « à prendre en compte non seulement les effets des actions humaines dans le monde, mais aussi leur mystérieuse genèse chez l’individu ».
Une pluie fine embrouillait les traits de la ville dont les bâtiments, d’habitudesi distincts, devenaient semblables à des bateaux flottants. Les parfums étaient d’automne, et pourtant le printemps s’annonçait dans les jardins d’Oxford-Nord où les daffodils s’organisaient contre l’absence de soleil. Devant la petite maison un peu décrépite que je finis par découvrir sur fond de grand silence matinal, les fleurs d’un magnolia jonchaient le sol. Je retrouvai cette impression d’abandon à l’intérieur, après qu’Iris Murdoch m’eût elle-même invitée à entrer.
Je m’étais fait une idée particulière du cadre dans lequel Virginia Woolf devait vivre: celui que j’avais sous les yeux lui correspondait tout à fait, étrange salon-aquarium où les canapés gardent l’ancienne mémoire des corps, où les tapis laissent lire leur trame, où les petites fenêtres ne laissent pénétrer qu’un jour chiche et verdâtre. La pluie, ce jour-là, était partout. Dans ce cadre, la formidable dame des lettres anglaises devenait fragile, seuls sa voix, merveilleusement conduite et timbrée, et son regard d’un bleu inquisiteur résistaient à la patine triste des choses.
QUELQUE CHOSE D’UNE SORCIÈRE
Inquiète de savoir en quoi elle pouvait m’être utile, sachant toutefois qu’on ne parlerait point de ses romans, Dame Iris – l’ordre du British Empire ayant été conféré à la romancière en 1987, il est de tradition de lui donner son titre sous cette forme – me regarda avec attention déballer mon magnétophone et mes multiples rallonges, puis elle m’avoua tranquillement: « J’ai quelque chose d’une sorcière, en ma présence ces appareils ne fonctionnent jamais. » Nous pûmes vérifier ses dires vers la fin de l’entretien, lorsque je vis la cassette bloquée en son milieu. Elle s’en amusa beaucoup. C’est sans doute grâce à cette défaillance que, par la suite, nous continuâmes notre entretien par écrit. J’en livrerai ici les éléments essentiels.
Le parallèle que l’on est tenté de faire avec Sartre s’effondre vite. Dame Iris ne croit pas en l’efficacité d’une littérature philosophique et regrette même que Sartre n’ait pas consacré plus de temps à un grand roman, car des grands romans écrits par des génies sont les meilleures totalisations possibles » d’un réel « à la diversité inépuisable et jamais systématisable ». Elle se voit comme une modeste disciple des grands romanciers du xixesiècle (en particulier Tolstoï et Dostoïevski) et se fait également humble devant la philosophie. Non point que quatre volumes de philosophie parus, quelques articles et des conférences (contre quelque vingt-quatre romans) représentent une trop mince contribution à la discipline: sa présence durant quinze ans comme Fellow et Tutorde philosophie au St-Anne’s College d’Oxford a laissé des traces, et elle me parlera de ses bonheurs de professeur.
HORS DU MOULE OXONIEN
Le déséquilibre entre l’œuvre philosophique et l’œuvre littéraire peut s’expliquer: en écrivant de la fiction, elle montrera que la préoccupation métaphysique n’est pas la chose privilégiée d’une petite élite universitaire – préoccupation uniquement partagée à Oxford par les théologiens, dont les prémisses diffèrent d’ailleurs par trop de celles du philosophe. Dans le cadre où elle l’exerçait, Iris Murdoch ne pouvait écrire la philosophie qu’elle souhaitait. Non pas, quoiqu’elle en dise, qu’il soit « bien plus difficile de faire de la philosophie que d’écrire des mots », mais parce que le moule rigide de la pensée oxonienne imposait le silence à ceux qui tentaient de l’élargir: « Pensez que de mon temps, j’étais encore étudiante, la philosophie était supposée commencer à Aristote. Pas question d’étudier Platon, considéré comme un écrivain ou même un poète. On ne le prenait pas très au sérieux. Ce qu’on enseignait était très étroit. Que quelqu’un se hasardât à ouvrir la Phénoménologie de l’esprit,il criait aussitôt au nonsense! ». À cette époque, tout ce qui n’était pas philosophie linguistique était relégué au placard. Si vous vouliez écrire un livre d’une certaine ampleur, consacré à la philosophie morale, il vous fallait discuter de questions telles que, que sont nos jugements moraux?, y a-t-il un langage moral, un langage religieux? Mais même à cela on n’attachait pas beaucoup d’importance. Je ne suis pas absolument sûre que les choses aient beaucoup changé aujourd’hui, à l’exception des aristotéliciens, qui sont un peu plus intéressés par la philosophie morale ».
Ainsi, fidèle à sa ville, Iris Murdoch s’est pratiquement depuis toujours détachée des courants de pensée qu’elle produisait, pour construire à travers ses romans, non point une théorie de l’action (« Toute théorisation est une fuite ») mais un univers où est enfin déployée l’infinie diversité humaine. De cette étoffe est l’univers shakespearien qu’elle admire, où la morale est « à son plus haut degré de raffinement, mais sans aucun dogmatisme »: « La grande littérature est moralement grande, elle rend possible les jugements sur la façon dont les êtres humains se comportent. La philosophie fait de son mieux, elle ne peut être complète au sens où l’art l’est, mais elle est tout aussi essentielle ». À l’inverse de son modèle, Platon, elle fera de la philosophie, à l’occasion, l’ancilla de l’art.
DES INVITATIONS DISSÉMINÉES
Après la guerre, Iris Murdoch connaît, dans les camps de réfugiés en Autriche, une humanité déshumanisée, elle contemple la « dérive totale de la société humaine ». Curieusement, cette expérience ne sera jamais reprise dans ses romans, peut-être par pudeur. Mais son souvenir permet de mieux comprendre sa quête: « Je ne suis pas véritablement une philosophe, sauf si l’on accepte de penser que le philosophe doit aider les gens à être bons. Disons que je m’occupe plutôt de psychologie morale », et de se demander si le seul critère valable du bien ne serait pas de savoir se comporter sans égoïsme dans un camp de concentration…
En 1970, paraît l’ouvrage The Sovereignty of Good: il n’y a pas en fait de critère du Bien, le Bien est « embarrassant parce qu’indéfinissable ». Nous n’en pouvons sentir que des « invitations disséminées », mais nous pouvons aussi « essayer parfaitement d’aimer ce qui est imparfait » et apprécier ainsi la relation entre Bien et Amour, même si le Bien demeure souverain. N’est-il pas tentant de dire que « agir avec amour traduit agir parfaitement, ce que ne peut faire agir rationnellement »?
Nous sommes loin de G.-E. Moore et des Principia Ethicaoù l’éthique est définie comme « l’investigation générale de ce qui est bien ». Elle conclut l’ouvrage par un éloge de la vertu d’humilité, « L’homme humble, parce qu’il se voit comme rien, peut voir les autres choses comme elles sont », ajoutant que rarement se manifeste cette authentique humilité, où l’on appréhende avec étonnement « l’absence des tentacules avares et inquiètes du soi ».
Au grand « Lucifer néo-kantien », elle préfère le « modeste receveur d’impôts de Kierkegaard », « même si ce n’est pas à la mode ». Comme je lui parlais de ce livre de philosophie « à contre-courant » que je la croyais en train d’écrire, elle me répondit qu’il n’avait maintenant plus la même urgence, après la lecture qu’elle venait de faire du livre « admirable » de Charles Taylor, Sources of the Self (Cambridge University Press, 1989), où « il explique en philosophe que la moralité ne doit pas être mise à l’écart du vécu, mais que c’est le tout de la vie, le centre de la vie ».
… PAS UN DESTIN
Platonicienne, donc, mais un Platon non aristocrate, attaché à l’univers des valeurs ordinaires. Albert Memmi ne disait-il pas récemment: « le philosophe qui considère la vie de trop loin, triche ou se ment ». Mais plutôt, l’ambition d’Iris Murdoch serait de montrer qu’il y a, dans l’ordinaire, de l’extraordinaire. C’est ce qui l’amène à se méfier de Heidegger, dont elle connaît bien, à l’inverse de ses contemporains, la pensée: « Je trouve queSein und Zeit est un grand livre, un jalon de l’histoire de la philosophie, au même titre que le Tractatus. L’un comme l’autre ont mis fin à l’inéluctabilité du cartésianisme. Mais je pense que l’un de ses objets est d’ôter de la scène philosophique – en fait de la scène humaine – le monde des valeurs ordinaires. Pourquoi les objets ne seraient-ils métaphysiques que dépouillés de leur valeur ordinaire et quotidienne? Pourquoi mépriser ainsi l’Alltaglichkeit?Ce mépris qui pointe dans Sein und Zeit fait grand dommage à la pensée philosophique. À côté de cela, il y a l’idée mystique eckhartienne – que l’on trouve aussi chez Rilke – qui est que nous devons faire venir Dieu en nous, en nous absentant de nous-mêmes. Seulement, si dans le premier Heidegger, il y a une sorte de bonne relation entre l’Être et ce qui le transcende, s’il appartient à l’homme de faire les premiers pas, dans les œuvres de la fin, l’Être est devenu un destin auquel on ne peut échapper. L’homme est devenu la victime de l’Être, il n’est plus l’homme créateur et vivant de Sein und Ait. Et cela est plein de désespoir, car on ne sait pas ce que cet Être nous réserve! Pas d’amour, pas de Dieu, rien qu’un destin. Il dit d’ailleurs quelque part, l’Être est sombre. Il dit aussi que nous devons accorder toute notre attention à l’Être, comme si rien d’autre ne pouvait nous conduire, aucune force morale, aucune activité morale. Dans ce monde de terrible souffrance, on pourrait bien mettre cette idée de l’Être de côté et, en attendant de savoir ce qui va se passer, nous pouvons tout aussi bien venir en aide à notre voisin… ».
LE VOISIN
En cet être ordinaire, notre voisin, Dame Iris voit un être extraordinaire, qui vit des extrêmes de peurs, de passions, de désirs, mais qui en contient les effets dans l’apparence de l’ordinaire. Ce sont ces êtres qui habitent ses romans. S’il arrive qu’elle les mentionne, elle en parle comme d’individus qu’elle fréquente régulièrement dont l’existence ne serait pas seulement romanesque, mais avec lesquels elle entretiendrait, précisément, des relations de voisinage. Ces individus s’offrent à nous dans l’opacité de leurs conduites et cela laisse parfois le lecteur de ses romans, en particulier des derniers, étonné devant un certain manque de cohérence. Reconnaître notre contingence et l’accepter est bien sûr à ce prix, en cette absence de sens. « Mais, me dit-elle, si nous sommes accidentels, cela ne signifie pas une sorte de relativité profonde qui évincerait le sérieux unique de la morale. La morale a besoin de la contingence ». Vladimir Jankélévitch n’écrivait-il pas: « la vertu n’est pas une potentialité inerte et purement logique, la conjecture ajoute quelque chose »?
Nous en sommes, à un moment, venues à parler du bouddhisme. Elle en a fait la rencontre en Inde, pays qu’elle a visité plusieurs fois et où elle peut « sentir la présence des Dieux ». Elle m’apprit à cette occasion que Wittgenstein lisait Tagore à la fin de sa vie (le héros de son dernier roman, Marcus Vallar, mathématicien génial qui abandonne les mathématiques pour la peinture, puis la philosophie, et qui finit son existence touché par la grâce d’un pouvoir de guérisseur, a peut-être quelques traits du philosophe). Au bouddhisme elle souhaiterait que l’Occident emprunte, en particulier, ses techniques de méditation: « Plutôt que de faire des cours de religion dans les écoles, on devrait apprendre aux enfants à méditer. Au début, cela les ferait sans doute rire. Mais quel achèvement! » Le bouddhisme, dit-elle, lui a « procuré une forme élémentaire de contemplation », lui a permis de repenser la vraie religion comme uniquement possible en l’absence de Dieu: « Vivre une vie véritablement religieuse, sans illusions », c’est être capable de retourner vers le monde et d’agir en vue du bien, pour rien.
UN DÉTAIL ALÉATOIRE
Ce pour-rien n’est-il pas l’essence de l’art? Non pas comme la gratuité d’un jeu, mais comme la gratuité même de la vie humaine. En lui, Dame Iris voit le « sauveur d’un temps sans absolu », en lui se montre « la vertu sans masque, dans son contexte de mort et de hasard »: «C’est l’art qui nous révèle ce que nous sommes habituellement trop égoïstes ou trop timides pour reconnaître, ce détail minutieux et absolument aléatoire du monde, auquel il donne forme et unité ». Seule contemplation qui soit jamais réellement vécue par la plupart d’entre nous, l’art est une sorte de « bonté par procuration ».
L’art, chez Iris Murdoch, n’éduque pas. Mais l’infidélité commise à l’égard de Platon est minime. Si pour elle, l’art est contemplation directe du réel, il offre comme telle les mêmes effets que l’éducation par le beau: là aussi le kalon rejoint l’agathon.