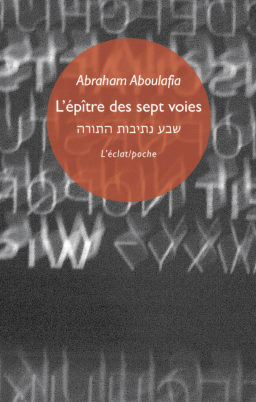Le texte qui suit
Le texte qui suit
a été lu par Emmanuel Fournier
lors de la présentation de
Insouciances du cerveau et Philosophie infinitive de poche
à la Librairie Michèle Ignazi, 17 rue de Jouy, Paris 4e, le 10 avril 2018.
D’entrée, je voudrais remercier vivement Michèle Ignazi qui, depuis tant et tant d’années, ouvre en grand et avec enthousiasme les portes de sa librairie à mes travaux, comme si cela allait de soi. Ma profonde reconnaissance, mes remerciements et mes pensées, je voudrais aussi les adresser à Michel Valensi, souffrant, qui regrette de ne pas pouvoir être là ce soir avec nous, et aux éditions de l’éclat qu’il dirige, particulièrement généreuses avec moi, puisque, non contentes de faire paraître les toutes nouvelles Insouciances du cerveau, elles les associent à une réédition en poche de Philosophie infinitive. J’y vois la marque d’une confiance imprudente dans des recherches qui se développent hors des sentiers battus, et parfois à contre-courant.
Puisque deux directions importantes de mes recherches se trouvent rapprochées par cette double publication, je dois, me semble-t-il, saisir l’occasion créée par l’entre-deux pour essayer de voir si ces branches, qui pouvaient paraître sans lien, ne procèderaient pas d’une même recherche, ou d’un même “esprit”, auxquelles les autres directions se rattacheraient aussi. Un travail de réassemblage, donc.
Et puisque nous sommes ici au milieu de livres, j’attirerai votre attention sur le caractère moins savant que littéraire de chacun de ces ouvrages. Je veux dire que le travail qui s’y fait porte avant tout sur les langues et sur les représentations que les langues nous donnent de ce qui est, sans prétention de “dire ce qui est” au-delà de ces langues.
Double lien des deux livres
Le premier lien qui réunit les deux livres, c’est la volonté de prendre quelques libertés à l’égard des contraintes qui s’exercent sur nos pensées, en l’occurrence des contraintes grammaticales et cérébrales. Si notre pensée dépend de conditions formelles ou matérielles, autant les connaître, et mesurer nos marges de liberté. Non pas les nier, ni nous y plier !, mais essayer de les surmonter ou de les retourner à notre avantage. Que nous soyons astreints à des attaches substantives ou cérébrales n’est pas une raison pour abdiquer devant elles.
Cette volonté s’appuie sur un certain nombre de croyances. Prendre des libertés, c’est croire que ces libertés ne nous sont pas données, ne nous appartiennent pas par nature, mais qu’il nous incombe de les saisir, c’est-à-dire qu’il nous revient à la fois de résister à une fatalité apparente, et d’explorer des horizons nouveaux que l’obéissance aux contraintes ne laisse pas soupçonner.
Par ailleurs, croire qu’il nous est possible de résister, c’est reconnaître que nous avons quelque peu cautionné, épousé ou même construit les contraintes en question. Sans doute qu’au départ elles nous ont ouvert des possibilités ou des pouvoirs. Mais sont-elles dès lors irrépressibles et obligées ? Certaines des contraintes et des conditions sous lesquelles nous nous représentons ou auxquelles nous nous plions n’ont que la prise que nous leur accordons. Il faut y renoncer ou se déplacer pour apercevoir d’autres possibilités qu’elles nous masquent.
Telles sont les croyances sous-jacentes à ces deux livres, et voilà pourquoi l’un et l’autre sont en même temps des tentatives de littérature et de libération : formuler autrement pour voir autrement, et réciproquement. C’est l’idée que gagner des libertés passe par des déplacements ou des transformations, à opérer là où s’échafaudent nos représentations, c’est-à-dire dans la langue. Et c’est l’espoir que le travail sur la langue fasse accéder à de nouvelles représentations et à de nouveaux points de vue.
Philosophie infinitive en poche
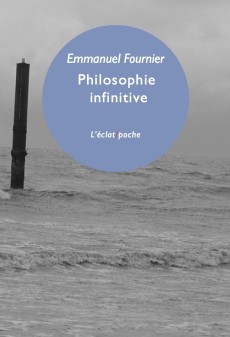 D’abord deux mots de Philosophie infinitive que j’avais eu le plaisir de vous présenter dans ce même lieu, lors de sa parution. À ce qu’on m’a dit, les quatre petits livres sont sortis de leur coffret pour aller se poser non sur des tables d’université, mais sur des tables de nuit ou des bancs de jardin, ou bien s’enfouir au fond de poches dont ils ne sont parfois jamais ressortis, mais où ils ont accompagné des promenades.[1]
D’abord deux mots de Philosophie infinitive que j’avais eu le plaisir de vous présenter dans ce même lieu, lors de sa parution. À ce qu’on m’a dit, les quatre petits livres sont sortis de leur coffret pour aller se poser non sur des tables d’université, mais sur des tables de nuit ou des bancs de jardin, ou bien s’enfouir au fond de poches dont ils ne sont parfois jamais ressortis, mais où ils ont accompagné des promenades.[1]
Les voilà rassemblées, les quatre cabanes, dans un vrai livre de poche, le grand hôtel des verbes, prêt à accueillir infiniment de pensées voyageuses dans ses chambres sobres. Avec cette édition ramassée, on n’aura pas à choisir son refuge. On pourra circuler entre les quatre cabanes sans regretter de ne pas avoir en poche celle où finalement l’on aurait bien aimé s’abriter un moment. Réunir ses enfants n’enlève à chacun rien de son caractère propre, de sa singularité et de son indépendance.
L’infinitif, langue de libération
En avant de l’ouvrage, en avant-poste de son avant-propos, on a ajouté le texte que j’avais écrit pour vous au moment de la première édition, et que j’avais lu ici-même, il y a tout juste quatre ans,[2] en vue de clarifier autant que possible l’idée que je me faisais de la langue infinitive et des perspectives qu’elle donne en philosophie.
Un mot (le deuxième donc), en complément, et qui vaut pour Insouciances. Si l’infinitif donne la voix aux verbes pour libérer les perspectives de pensée qu’ils détiennent, il constitue d’abord une révolte contre le langage, notamment contre les noms, ou plutôt contre les fonctions qu’on leur demande de tenir pour nous : poser des objets, établir des codes, des règles, des normes, sur lesquels nous sommes sommés de nous entendre. Qu’ils le veuillent ou non, les noms nous conduisent peu ou prou à délimiter un réel et à intégrer une culture ou une communauté de pensée qu’on les charge de verrouiller. Ils font de nous des initiés ; et de nos langues, ils font des sortes de jargons difficilement compréhensibles pour les non-initiés, et pour les poètes.
Il y a des libertés à prendre de ce côté-là, dès lors qu’on a pris conscience que les noms nous disent un peu trop comment sont les choses pour les laisser être et pour nous laisser nous-mêmes être. Aller à l’infinitif, c’est refuser d’être initié, refuser les noms qui savent et qui rejettent. Ce n’est pas chercher à instruire ou à convertir l’autre, mais à le mettre en condition de penser, s’il le souhaite. C’est confier le lecteur et se confier, soi, à un langage sauvage, fait des mots les plus nus, verbes non conjugués et conjonctions, assemblés dans le respect des règles grammaticales élémentaires, mais du fond du ventre ou de l’inquiétude. Une langue légère, simple. Légèreté déroutante, tant on a l’habitude d’en rajouter. Simplicité qui paraît paradoxalement abstraite et complexe, tant elle ouvre de possibilités. Je vous laisse y méditer à nouveau.
De Creuser la cervelle à Insouciances du cerveau
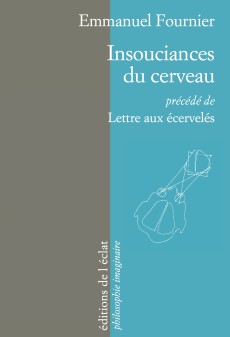 Insouciances du cerveau procède d’un semblable refus, refus notamment de la neurolangue qui nous envahit, qui fait de nous des initiés et qui nous plie à son mode de vision. Je parle de cette langue qui fait que nous nous pensons en termes cérébraux. Je peux maintenant prétendre ne plus diriger ma vie, mais subir les caprices et les humeurs de mon cerveau qui cherche son bien-être et son accomplissement social. On dit : « Ne croyez pas que j’aille courir le dimanche matin pour mon plaisir, mais parce que mon cerveau a besoin de sa dose d’endorphines et d’une activation de ses aires d’autodépassement. » Les besoins sont d’abord les siens. N’est-ce pas notre cerveau désormais qui croit, qui pense, qui aime plutôt que nous ? On laisse d’ailleurs la neurolangue penser à notre place d’autant plus naturellement qu’on s’en remet innocemment à elle. Qui oserait s’élever contre sa caution scientifique et médicale ? Pour guider nos vies, ne devons-nous pas nous confier à ceux qui connaissent le cerveau et peuvent nous aider à en prendre soin mieux que nous ne pourrions le faire nous-mêmes ?
Insouciances du cerveau procède d’un semblable refus, refus notamment de la neurolangue qui nous envahit, qui fait de nous des initiés et qui nous plie à son mode de vision. Je parle de cette langue qui fait que nous nous pensons en termes cérébraux. Je peux maintenant prétendre ne plus diriger ma vie, mais subir les caprices et les humeurs de mon cerveau qui cherche son bien-être et son accomplissement social. On dit : « Ne croyez pas que j’aille courir le dimanche matin pour mon plaisir, mais parce que mon cerveau a besoin de sa dose d’endorphines et d’une activation de ses aires d’autodépassement. » Les besoins sont d’abord les siens. N’est-ce pas notre cerveau désormais qui croit, qui pense, qui aime plutôt que nous ? On laisse d’ailleurs la neurolangue penser à notre place d’autant plus naturellement qu’on s’en remet innocemment à elle. Qui oserait s’élever contre sa caution scientifique et médicale ? Pour guider nos vies, ne devons-nous pas nous confier à ceux qui connaissent le cerveau et peuvent nous aider à en prendre soin mieux que nous ne pourrions le faire nous-mêmes ?
La question est de savoir de quel cerveau on parle. On aurait envie d’établir une distinction. Dans nos discours, nous confondons à plaisir deux cerveaux, un cerveau matériel et un cerveau imaginaire. Le cerveau matériel, c’est celui sur lequel se penchent les neurophysiologistes, les neurologues et les psychiatres, cerveau réel donc, qui n’engendre sans doute ni le monde, ni la pensée, mais qui en est une condition matérielle et qui joue un rôle crucial dans la mise en forme de notre façon de penser, d’appréhender le monde, de nous percevoir nous-mêmes et de conduire nos vies. Le discuter serait une offense à ceux qui souffrent d’affections du cerveau, mais aussi à ceux qui font du cerveau leur objet de travail et de sollicitude. C’est dit.
L’objet d’Insouciances n’est pas ce cerveau-là, mais celui dont nous nous émerveillons lorsque nous pensons aux “capacités prodigieuses” de notre cerveau, c’est-à-dire le cerveau dont nous faisons l’auteur de nos pensées et de nos comportements, dont nous nous emparons pour repenser notre condition et que nous donnons comme raison de ce que nous faisons et de ce que nous sommes. Le passage du cerveau bien réel de la pathologie et de l’expérimentation neurophysiologique, à ce cerveau imaginaire doit beaucoup à l’imagerie cérébrale dont se nourrit précisément notre imaginaire. L’imagerie nous donne au fond un double de nous-mêmes à contempler et à fantasmer. Un double en nous-mêmes, et un alter ego bien réel puisqu’il se laisse voir et imager. Un complice bien précieux puisqu’il nous explique en nous remplaçant. C’est comme si notre identité se dédoublait dans un nouveau dualisme cerveau-personne. Il y a moi et il y a mon cerveau et ce n’est pas la même chose. S’il prend ainsi corps, je vais pouvoir me fonder sur lui, me décharger sur lui, me cacher derrière lui, m’en servir pour toutes sortes d’usages, éventuellement contraires. Car ce double permet aussi bien à autrui de m’excuser et de me disculper (« Ce n’est pas lui, c’est son cerveau. ») que de me stigmatiser et de me condamner (« C’est son cerveau, on ne peut rien pour lui. »). Un tel cerveau à tout faire est fort utile en neuropédagogie et en neurojustice, où il est appelé à comparaître aussi bien à charge qu’à décharge. Et nous propageons nous-mêmes les fructueux usages et la bonne parole qui nous a colonisés sans nous préoccuper de véhiculer un mode de pensée qui nous contraint et qui nous met à la merci de manipulations bien réelles (« Le traitement va seulement corriger une dysfonction de votre lobe frontal et de vos centres de l’humeur. »). Belle ruse de ce double, symbolique ou idéologique, grâce auquel on peut traiter quelqu’un sans paraître attenter à sa personne.
On comprend qu’il n’est pas tout à fait anodin de nous voir dans les termes de la neurolangue, et que des intérêts pratiques sont en jeu derrière les mots et les représentations. Je dois accepter que l’ignorance où je suis de ce qui se passe en moi et l’impuissance où je demeure de moduler mon sort me mettent dans une situation de dépendance vis-à-vis de ceux qui, par leur science du cerveau ou par leur position technique, peuvent avoir de tels savoirs et de tels pouvoirs sur mon double. Suis-je bien inspiré de placer ma condition réelle et mon avenir concret entre leurs mains ?
Ces remarques – cette douce révolte – inspiraient déjà le livre précédent, Creuser la cervelle[3]. Il y était déjà question des difficultés à trouver comment se placer vis-à-vis du cerveau, dont il ne serait pas raisonnable de nier qu’il joue un rôle quelconque pour nous, mais auquel nous sentons bien, pourtant, qu’il serait déraisonnable de nous réduire et de nous asservir.
Qu’y avait-il à ajouter à Creuser la cervelle ? Je ne me serais pas lancé dans Insouciances du cerveau s’il n’y avait pas eu l’espoir de gagner, grâce à l’idée de cerveau, des pensées plus libres encore, des “insouciances” plus profondes ou plus générales, qui dépassent le sujet cerveau. L’espoir aussi d’explorer simultanément de nouveaux lieux d’où regarder et d’où exprimer. Il me semblait qu’il fallait préciser un tout petit peu plus ce que nous voulons dire quand nous espérons apprendre du cerveau ce que nous sommes. Il fallait non pas mettre des points sur les i – comme si j’avais enfin trouvé la vérité dernière –, mais creuser l’insouciance.
D’un côté, bien comprendre et montrer qu’il peut être éventuellement laborieux de démonter les rouages du cerveau et d’en décortiquer les pannes, mais qu’il n’y a pas de difficulté d’ordre métaphysique à donner une explication de ce que nous sommes en termes cérébraux ou physicochimiques. Qu’on peut éprouver une certaine curiosité, voire un émerveillement, à étudier comment il est possible de nous redécrire en ces termes et de mettre ces re-descriptions en continuité avec nos façons ordinaires de nous représenter. Qu’on peut ainsi donner un sens à la question des relations de l’esprit au cerveau, et avoir en définitive la conviction de lui apporter une réponse claire et pragmatique. Je ne doute pas que l’humanité me soit à jamais reconnaissante d’avoir résolu le fameux problème de l’âme et du corps.
D’un autre côté, il fallait démonter l’illusion qu’une telle redescription nous fasse enfin découvrir ce que nous sommes. Comme si nous ne le savions pas auparavant, et comme si nous découvrions autre chose que notre faculté illimitée de nous décrire autrement. Ou plus exactement, démonter l’illusion que les images du cerveau disent tout ce que nous sommes, ne sont pas seulement des représentations, et que nous avons avantage à les substituer à nous. Le livre détaille la série d’opérations qui permettent d’une part de fabriquer des images du cerveau selon ce qu’on cherche, et d’autre part, de changer de regard, de sorte à croire qu’en se penchant sur les images fabriquées, on y voit tout ce qu’il y a à voir de la pensée, sans résidu et sans autre dimension cachée.[4] Moyennant quoi, la pensée finit par se redéfinir comme cérébrale et se résoudre entièrement dans ce qui est cérébralement visible. Pour que l’illusion fonctionne, nul besoin de preuve scientifique. Il nous suffit d’avoir des images du cerveau qui donne un fondement à l’élan que nous y cherchons. L’essentiel du bénéfice est tiré de la reformulation. « Mon cerveau, au plus profond de mon moi, va me permettre de m’épanouir », c’est l’idée qui fait rêver, pas les fastidieuses démonstrations scientifiques qu’il faudrait entreprendre.
Je ne vois pas pourquoi je chercherai à priver quiconque d’une illusion, mais il me semble qu’une illusion est plus savoureuse dès lors qu’on ne se laisse pas seulement berner par elle, et qu’on est conscient de ce qu’elle est, une illusion, irrépressible ou non. C’est le jeu avec soi qui est source de jouissance. En l’occurrence, l’illusion est une pieuvre à mille bras. S’enchanter de l’idée de cerveau demande de jouer avec l’imagination qu’en regardant en lui nous allons trouver non seulement 1) ce que nous sommes et 2) la manière dont nous pensons, mais aussi 3) la manière dont nous devrions penser et nous comporter, 4) la manière de considérer les autres, le monde et tout ce qui nous entoure, 5) la manière de remédier à tous nos maux, 6) la manière de nous améliorer, par la neuropédagogie, la neuroéthique, la neurojustice, la neuroéconomie, la neurosociologie… ou même de nous “augmenter”.
Qu’on se réjouisse à ce sujet. Pour l’instant, les recettes que les neurosciences sont fières de nous donner à l’issue de leurs recherches hardies ne mettent pas en danger nos croyances ordinaires : faire attention pour être conscient, répéter pour mémoriser, dormir pour se reposer, obéir pour se rassurer, partager pour avoir bonne conscience, etc. Ce que leur savoir nous dévoile avec prévenance n’est souvent rien que ce qu’un enfant apprend avec les mots du vocabulaire. Faut-il s’en étonner ? Si le cerveau est à l’origine des solutions éthiques ou pédagogiques que nous sommes amenés à imaginer pour optimiser nos conduites et nos apprentissages, son étude permet éventuellement de donner des explications matérielles à chacune, mais pas de déterminer que l’une vaut mieux qu’une autre. Comme l’attribution de telles valeurs se fait dans d’autres sphères que cérébrales, ceux qui prétendraient trouver dans le cerveau comment nous devons penser et qui se mettraient en tête de fonder sur lui une neuroéthique, une neuroesthétique, une neuropédagogie, une neuroéconomie… ne feraient que projeter leurs propres idées sur ces questions et chercher dans le cerveau une caution matérielle et scientifique. Il est vrai que le cerveau n’est rien sans une pensée qui le mette en forme.
Nécessité d’ironie
Moquez-vous comme vous le devez de ce système extravagant. Savez-vous ce qui vous arrivera ? On vous prendra pour un obscurantiste. Méfiez-vous des jargons, des fantasmes et des dogmes dont le cerveau s’entoure, opposez-leur un ton différent, des termes autres, on vous fera passer pour un poète parce que vous chercherez à réfléchir et que vous vous efforcerez de ne pas céder à un langage. Pourtant, n’est-ce pas d’abord sur le terrain de la langue que se jouent la lutte et les résistances ? La retenue ne doit-elle pas commencer là ? [5]
Comment mener à bien l’entreprise critique ? Me confier aux neurosciences elles-mêmes afin qu’elles augmentent ma créativité critique ? Pourquoi pas ? Pour libérer la créativité, lit-on dans la presse, il suffit d’activer l’aire de l’intuition dans le cortex préfrontal, et de désactiver les aires corticales de la censure et de la planification, suivant l’idée – osée – que la créativité nécessite de faire preuve d’intuition et de résister à notre propension à la censure et à la planification. Pour être davantage créateur, il ne me reste plus qu’à me fourrer dans le crâne une électrode qui active à haute fréquence mon cortex de l’intuition et deux autres électrodes qui réfrènent mes aires de la censure et de la planification.[6]
Faute de savoir me consoler avec ces riches représentations et d’avoir accès à mes aires cérébrales, l’écervelé que je suis a dû se contenter de travailler sur les mots. Le travail d’écriture ne s’est pas tant porté sur les formes[7] que sur ce qu’on pourrait appeler « le ton », afin d’accéder petit à petit à des positions différentes.
Pour ce travail, il ne fallait pas de jargon, que ce soit scientifique ou philosophique.[8] Non, il fallait un langage très simple, très ordinaire, qui retourne les pièges de la neurolangue et qui fasse entendre autre chose que ce qu’elle veut dire. Autrement dit, une ironie, un peu plus incisive que celle de Creuser la cervelle. Voltaire et Foucault se sont constitués alliés de cette entreprise. Non par ce qu’ils ont dit sur le cerveau, mais par transposition de ce qu’ils ont dit sur d’autres sujets, en reprenant leurs verbes.[9] Des transpositions qui vont m’attirer les foudres des gardiens des temples.[10]
On va accuser ce livre de traiter à la légère des questions très sérieuses. Mais si l’on voulait déjouer la pente de normalisation et d’asservissement sur laquelle l’idée de cerveau tend à nous faire glisser, n’était-ce pas justement une légèreté qu’il fallait essayer d’atteindre, vis-à-vis de l’idée de cerveau comme vis-à-vis d’autres idées trop substantivées ?
D’une insouciance à l’autre
Au fond, il s’agit d’opposer des insouciances à l’idéologie du cerveau. Le livre part d’une première insouciance confiante qui consisterait à s’en remettre innocemment au nouvel ordre cérébral et aux neurodiscours qui structurent celui-ci.
J’apprends que je ne sais rien, sinon que mon cerveau sait et apprend pour moi tout ce qu’il faut, qu’il me donne conscience de ce qu’il veut, quelques miettes par-ci par-là quand il lui plait, et que je n’ai besoin de rien de plus, qu’il décide de tout pour moi, et toujours au mieux, qu’il me fait vouloir ce que j’appelle liberté, et préjuger ce que je crois penser. Je dois faire avec lui et, qui plus est, le laisser faire. Mon cerveau, me dit-on, me laisse dans la plus simple ignorance, il fait de moi cet écervelé qui interroge et qui dit « je » sans savoir de quoi il retourne, et il fait bien ainsi.[11]
À partir de cette insouciance qu’on pourrait appeler « de décharge », le livre développe toute une gamme d’insouciances à jouer, insouciances de dédoublement, de retournement, de distanciation… qui comprennent l’idée de cerveau comme un refuge d’imaginaires et d’aspirations très peu scientifiques, et qui acceptent affectueusement les raisons que nous avons de nous représenter de cette manière. Pour autant, ces insouciances ne dispensent pas de penser.
Comment me comporter ? Je le demande à l’organe de la pensée, mais il me laisse dans mon questionnement. Et cela est logique. S’il se prend pour moi, alors qu’il doute à ma place. À lui les inquiétudes, les cogitations, les élucubrations, les contradictions ; à nous le rire et la légèreté, car ni lui, ni ceux qui ont prise sur lui ne nous attrapent tout à fait.[12]
Nous ne sommes pas tenus de nous affilier corps et âme au nouveau point de vue et de tomber dans une nouvelle idéologie. Chercher des déterminants cérébraux à nos façons d’être n’efface pas les autres déterminants que nous pouvons leur attacher. Le cerveau vaut parce qu’il permet d’échapper à des représentations morales, psychologiques, littéraires, poétiques… Ce n’est pas une raison pour renoncer à ces autres représentations qui ont leur nécessité et qui peuvent en retour nous aider à nous libérer du cerveau. L’important est peut-être avant tout de pouvoir circuler entre les représentations que nous nous faisons. Autrement dit, le bénéfice à espérer de nous voir en termes de cerveau n’est pas de remplacer une vision, une langue ou une vérité par une autre plus solide, plus scientifique ou de plus grande valeur. Il est surtout de pouvoir aller de l’une à l’autre, nous échapper de l’une par l’autre, une liberté que nous aurions tort de nous refuser. C’est dans l’espace ouvert entre toutes nos dimensions que nous avons à tenter notre chance, notre insouciance. Mon objectif n’était rien d’autre : trouver des clés pour sortir d’un neuroenfermement et les donner à ceux qui voudraient.
Dédicace
À la fin de la présentation de Philosophie infinitive il y a quatre ans, j’avais proposé un petit moment de philosophie pratique à ceux qui souhaitaient une dédicace pour eux ou pour quelqu’un de proche : ils piochaient deux des cinquante verbes qui constituent la matière première du texte, et j’inscrivais sur leur ouvrage la proposition infinitive de deux verbes que la chance leur donnait ainsi à penser. Je propose de reprendre cette pioche de deux verbes pour les dédicaces de Philosophie infinitive ; et d’ajouter simplement le préfixe “neuro-” à l’un des verbes piochés, pour ouvrir les Insouciances du cerveau (les ouvrir en les confiant à leurs alliés infinitifs). Après tout, n’importe quel verbe peut faire l’objet d’une neurodétermination ou d’une neuroattention. Prendre pour point de départ un verbe comme neuropouvoir, neuroêtre, ou neurocroire… devrait déjà donner beaucoup à penser au destinataire.
[1] D’après ce que j’ai compris, ils donnent le « la » à des méditations personnelles ou des rêveries solitaires, quand ils ne préparent pas le sommeil, dans le sursaut d’éveil et de présence que demandent les propositions infinitives. Certains les lisent d’une traite comme des suites, d’autres picorent de-ci de-là de quoi lancer une réflexion individuelle. Ce sont des livres de chevet ou des livres de poche, qu’on n’ouvre pas nécessairement, qu’on ne lit pas toujours méthodiquement, des livres qui se contentent de proposer et d’accompagner, sans souci d’imposer et de dominer.
[2] Un 10 avril, comme aujourd’hui, jour anniversaire.
[3] Creuser la cervelle. Variations sur l’idée de cerveau. PUF, 2012.
[4] De même qu’il a fallu changer de regard pour que les médecins voient la maladie s’inscrire sans reste dans le corps. Qu’est-ce qui fait qu’un regard différent devienne pertinent ou non ? Qui sait si la voyante qui lit notre bonne aventure dans les lignes de nos mains ne voit pas ce qu’elle dit ?
[5] Insouciances du cerveau, p. 27.
[6] Insouciances du cerveau, p. 124.
[7] Insouciances du cerveau s’appuie sur des formes déjà expérimentées dans des ouvrages précédents. Creuser la cervelle était fait de neuf suites de neuf variations. Insouciances est constitué de quatre suites de seize variations chacune. Ces quatre suites s’intitulent et étudient : 1. – Pourquoi écouter le cerveau ? – 2. Comment faire parler le cerveau ? Comment voir la pensée ? – 3. Que faire dire au cerveau ? Pourquoi le lui faire dire à notre place ? – 4. Quelle oreille prêter au cerveau ? – Elles sont séparées et coupées par des carnets et des remarques qui les rappellent à un certain désordre (cf. L’infinitif des pensées, éditions de l’éclat, 2000). Elles sont suivies par un résumé final, tout en noms, qui prolonge La comédie des noms (éditions Éric Pesty, 2016). Le tout, accompagné de petits dessins réflexifs de nature à contenter le lecteur pressé (cf. Se confier à l’île, éditions Locus solus, 2015).
[8] Ce n’est pas que j’aie quelque chose contre les jargons. Ils ont leurs raisons d’être pour mettre en forme des questions spécialisées, dérouler leurs idées, laisser tourner leurs mécaniques, et nous dispenser de penser, tranquilles derrière eux. Mais s’ils sont bien placés pour parler à notre place ou pour parler d’autre chose que de nous, sont-ils bien placés pour interroger ce que nous sommes et parler de ce que nous cherchons ?
[9] Les transpositions peuvent être envisagées comme des sortes de déplacement de point de vue qu’on effectue le long de verbes : on change les noms et les objets autour de la composition verbale qui assure la fonction transposable. La langue infinitive, où aucun objet n’est plus stipulé, constitue une formulation générale des questionnements particuliers, ce qu’en mathématiques, on appelle un “passage à la limite”.
[10] Les voltairiens (je ne crois pas qu’il y en ait beaucoup hélas), les foucaldiens (ceux qui ont lu Foucault me pardonneront, ou même acquiesceront) et surtout les témoins de la nouvelle neuropensée – ils se rassureront en pensant que ces transpositions sont des gestes de poète (en croyant ainsi en désamorcer la charge). Qu’ils se rassurent surtout en pensant que je ne me permettrais pas de dire du mal d’un autre cerveau que du mien.
[11] Insouciances du cerveau, p. 14.
[12] Insouciances du cerveau, p. 51.