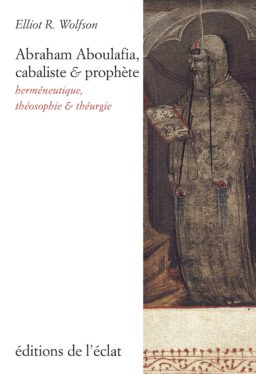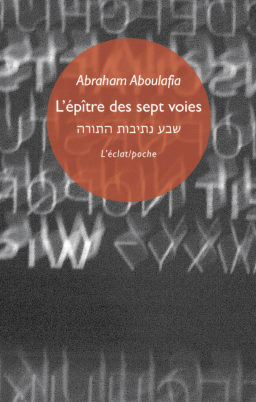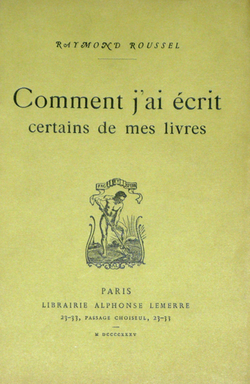 Présentation par Emmanuel Fournier
Présentation par Emmanuel Fournier
Librairie Tschann, Paris 6e, 25 octobre 2021, 19h30 et suivantes…
Avant toute chose, je voudrais vous remercier toutes et tous d’être venus aujourd’hui participer à cette présentation que je suis heureux de faire avec Éric Pesty, éditeur. Et je tourne aussitôt mes remerciements vers la librairie Tschann qui nous accueille avec autant de générosité et de simplicité. Je n’ai pas oublié, et Éric non plus, qu’il y a quinze ans déjà, dans sa vitrine, Tschann avait soutenu en grand la sortie de mes deux livres 36 morceaux et Mer à faire, et le démarrage des éditions Éric Pesty qui se faisait par ces parutions, avant bien d’autres qui les ont rendues fameuses depuis.
Nous parlerons ce soir d’un nouveau livre un peu particulier qu’Éric a accepté de publier, Tractatus infinitivo-poeticus, et aussi d’un autre livre paru cet été également, être à être, aux éditions de l’Éclat. Michel Valensi qui est l’éditeur de ce dernier n’a pas pu nous rejoindre, mais il a œuvré avec détermination pour que cette soirée ait lieu, de même qu’il accompagne mes expéditions infinitives successives depuis trente ans, sans montrer la perplexité que le caractère périlleux et incongru de ces expéditions n’a pas dû manquer de lui faire éprouver. Qu’ils reçoivent, lui en son éloignement attentif, et Éric en sa présence chaleureuse, l’expression de ma profonde reconnaissance pour leur soutien fidèle. On me demande parfois si, arrivé à plus de 60 ans sans être publié par les éditions Rolex, je n’ai pas le sentiment d’avoir raté ma vie, mais qu’ai-je raté là ? J’ai la chance de travailler avec deux des deux plus grands éditeurs de philosophie et de poésie, à la fois scrupuleux et aventureux. Quels autres éditeurs pourraient mieux m’aider à vivre et à être au quotidien, car c’est ce dont il est question et ce qui nous importe (plus qu’une image de vie), non ?
Donc deux livres. Nous nous interrogerons à leur sujet, Éric et moi, et vous aussi si vous le souhaitez. J’essaierai ce soir de vous dire comment je les ai personnellement vécus. Quelques mots de leur histoire et de la façon dont ils se sont faits, des choses qui ne se disent pas dans les livres. L’émotion de vous rencontrer et l’envie d’être à la hauteur de l’attention que vous m’accordez m’ont poussé à aller plus loin dans la réflexion, au-delà de ce qui est écrit au sein des livres. Ces mots sont pour vous. Je les lirai dans leur précision d’écriture, en alternance avec des passages extraits des deux livres, et en réponse aux questions qu’Éric posera.
À l’origine des deux livres – Retour sur la langue infinitive
— Les deux livres récemment parus font appel à ce que vous appelez la langue infinitive que vous avez introduite comme une méthode d’ouverture en philosophie dans Croire devoir penser en 1992 et que vous avez développée ensuite dans Philosophie infinitive (Éditions de l’éclat, 2014). Pourriez-vous revenir sur les intentions de cette méthode infinitive et sur les raisons de la reprendre aujourd’hui en deux livres ?
Pourquoi deux livres en même temps ? Comment en est-on arrivé là ? Comme si une fragilité n’allait pas aggraver l’autre !
Qu’ils soient deux et qu’ils s’associent pour constituer les volets d’une sorte de diptyque dépareillé ne surprendra pas ceux qui connaissent un peu mes ouvrages antérieurs et qui ont remarqué que depuis l’origine, ils se composent (et se provoquent) en diptyques mobiles, suivant le schéma et la dynamique d’un grand jeu de domino. Je trouve dans ce modèle une force productrice (où chaque ouvrage, mis en position d’incomplétude, en appelle d’autres) et une force protectrice contre les enfermements, par sa capacité à déployer des dimensions opposées, voire contradictoires, et à les assembler souplement, deux en un ou deux à deux, de façon non définitive.
En l’occurrence, le diptyque n’était pas parti pour être ce qu’il est devenu. Le projet de être à être est né à Ouessant en juillet 2013, immédiatement après la fin de l’écriture des quatre livres tout en verbes, Penser à être, à croire, à penser, à vivre, regroupés sous le titre Philosophie infinitive. Être à être et, plus tard, Tractatus sont venus dans le prolongement de ces livres, ils en approfondissent les préoccupations. Tous tentent de surmonter une difficulté majeure, me semble-t-il, à l’orée de toute philosophie, qui est d’avoir pour outil un langage de noms et de concepts qui, peu ou prou, disent d’avance ce qui est, comment être et comment vivre, qui sont faits pour cela et qui sont fort utiles pour ne pas se poser de questions.
Comme si la mission de la philosophie était de dire ce qui est et comment vivre, de définir, d’objectiver et d’instituer – de suivre ces verbes-là, à l’instar des pratiques scientifiques –, et de cautionner ce que les noms et les concepts semblent affirmer ou désigner. (Comme si penser consistait seulement à élucider, découvrir ou déduire les préjugés ou les idées qui se logeaient dans les noms composant les prémisses de nos raisonnements.)
Et comme s’il fallait, nous, y croire et y obéir. (Comme si se conforter et finalement ne plus avoir à penser étaient nos objectifs ultimes.) Et en effet, nous pouvons bien croire et obéir aux choses, parfois trop générales et convenues, que nous demandons aux noms de dire, de déterminer et de penser pour nous. Ce qu’est la liberté, par exemple. Et peut-être momentanément tirer grand contentement des assurances ou simplement des aides que nous nous donnons ainsi.
Mais procéder de la sorte, n’est-ce pas se mettre en contradiction avec un autre vieux projet de la philosophie qui est de s’étonner, de douter – sans faire semblant –, de réfléchir, de réenvisager les choses, de se poser des questions à leur sujet, de penser, d’être et de vivre – vraiment – en acte, et non en s’installant dans une pensée dite d’avance, arrêtée et condamnée avant même de faire ou de penser quoi que ce soit, ou prisonnière ensuite de la gangue de noms et de normes qu’elle secrète sur mesure ? Dire ce qu’est la liberté (par exemple), n’est-ce pas en faire un objet et trahir l’idée même de libérer ?
Si nous voulons envisager les choses, les êtres et la vie sans les supposer, les affabuler ou les déterminer d’avance, si c’est voir, être et vivre que nous voulons, ne faut-il pas revenir sur la langue que nous recevons comme outil, la trafiquer un peu pour qu’elle ne nous envoie pas dans le mur sans même que nous le voyons venir ? Revenir sur la méthode, notamment sur les appuis que nous recevons des noms, sur les aides que nous allons chercher en eux et sur les embarras et les entraves qu’ils nous mettent. Ouvrir la langue. Nous tourner vers les verbes.
« Je comprends votre langue et je l’admire, mais quand vous me dites ce qui est, je ne peux pas m’empêcher de me demander comment vous le faites être. » À quels verbes nous confions-nous pour opérer innocemment, parfois inconsciemment, nos représentations et, au-delà, nos choix de vie. Ne gagnerions-nous pas à nous les rendre apparents et à reprendre l’exploration de ce qui est, de comment être et de comment vivre, en toute conscience de ce qui se fait.
De là la langue infinitive, une langue délibérément étrangère et inhabituelle, toute en verbes – pour bien voir ce qui se dit et ce qui se fait –, et en mode infinitif, en verbes non conjugués qui attendent tout de nous, qui nous interrogent sur ce que nous voulons faire et qui nous invitent ou nous engagent à être, à croire, à penser, à vivre, à nous mettre à l’œuvre. Et de là, dans les quatre livres de Philosophie infinitive, une recomposition des questions philosophiques dans une dynamique radicalement ouverte et requérante.
À la fin de leur écriture, le quatuor constituait une sorte de diptyque au carré, qui en principe n’avait besoin de rien de plus et qui en effet peut se suffire à lui-même. Dès lors, pourquoi un livre encore, et même deux ?
Aussi autonomes soient-ils, les quatre livres n’en relançaient pas moins les interrogations, loin de les clore. Interrogations sur le fond– faut-il vraiment en venir à une dynamique infinitive pour poser et résoudre nos questions d’existence et de vie ? quelle sorte de philosophie en espérer ? est-ce qu’il ne lui échappe pas quelque chose, du côté des noms et de l’être – et c’est être à êtrequi s’est chargé de ces questions, en venant, à l’origine, doubler Philosophie infinitive.
Et interrogations sur la forme– comment composer les verbes qui tendent nos vies ? – et c’est Tractatus infinitivo-poeticusqui est finalement venu doubler être à êtreet composer de fait le nouveau diptyque.
Par ailleurs, les unes et les autres de ces interrogations ne demandaient-elles pas à la philosophie infinitive de se confronter de nouveau aux “pères” et aux autres façons de faire la philosophie ?
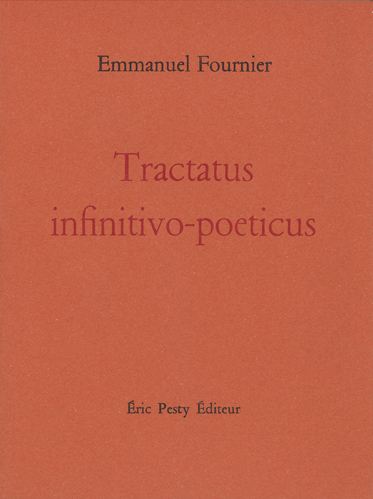 Composition de Tractatus infinitivo-poeticus
Composition de Tractatus infinitivo-poeticus
— Le Tractatus est composé de 36 textes, qui habitent ou investissent chacun une page comme le ferait un poème, et qui ne sont pas sans rappeler les dessins publiés sous le titre 36 morceaux (éditions Éric Pesty, 2005). Ces textes sont numérotés comme dans un traité et la note initiale du livre place celui-ci dans la perspective de relancer les interrogations du Tractatus théologico-politicus de Spinoza et du Tractatus logico-philosophicus de Wittgenstein. Comment en êtes-vous arrivé au projet de jouer sur le mode infinitif pour prolonger les questions de ces traités ?
Tractatus infinitivo-poeticus est issu d’une réflexion sur la forme sous laquelle les textes de Philosophie infinitive avaient été initialement formulés. La question a été suscitée par la proposition de Michel Valensi fin 2016 de republier les quatre livres en un volume de poche aux Éditions de l’éclat. Mais republier, n’est-ce pas s’engager à faire un autre livre ? (Pour qui n’aime pas faire deux fois la même chose exactement, une perspective de réitération ou de recommencement devient une occasion de variation. Faisons-nous d’ailleurs jamais la même chose ? Alors, varions délibérément !) La publication en poche ne prévoyait pas de récrire ni même de retoucher le texte. Mais la forme ?
Dans les quatre livres de Philosophie infinitive, les problèmes philosophiques sont formulés en brefs morceaux de 3-4 lignes, constitués de quelques propositions, composées sur une métrique commune (de 9, 10, 11 ou 12 pieds selon les morceaux). Une métrique qui porte les verbes à se composer et qui aide la lecture à avancer (à aller au-devant des verbes suivants). Rien d’inutile. Pas de bavardage verbeux ! Rien que les verbes indispensables, les uns à la suite des autres, croisés entre eux. L’expression des questions philosophiques au plus court, avec condensation en chaque infinitive de toutes les questions voisines, et possibilité – lors de mises en application – de décliner chacune en pages et en pages si envie, en lui ajoutant des noms, des adjectifs et des spécifications de contexte à l’infini. Bref du concentré de philosophie en chaque morceau, avec saut d’une ligne et passage au suivant, sans place perdue. Toute la philosophie ramassée en quatre petits volumes, pouvant se ranger dans un coffret.
Cependant, ne pourrait-on mettre ces morceaux dans une forme qui en rende apparente la métrique souterraine (c’est-à-dire les mettre en vers pour fluidifier la lecture en la rythmant visuellement), mais surtout une forme qui explicite et rende visible la façon dont les morceaux se sont composés ? C’est de cette curiosité que vient le Tractatus infinitivo-poeticus.
Le propre de la méthode infinitive est en effet de construire des propositions avec les verbes qui se trouvent là (ou qu’il faut aller chercher) et avec la boîte de conjonctions que la grammaire met à notre disposition. Quelles idées ou quelles angoisses nous guident, ou bien quels désirs, ou simplement quels “motifs”, nous poussent à user de tels verbes pour exprimer nos questions?
Croire devoir ? Devoir penser ? Croire penser ?
D’un autre côté, pourquoi certaines combinaisons de verbes nous parlent, nous interrogent, prennent sens pour nous, ce sens fût-il indéterminé et problématique ? Comment se fait-il que nous y voyons matière à réfléchir ou problème philosophique ? Et pourquoi d’autres combinaisons ne le font-elles pas ? (Ceci dit, je n’ai pas trouvé de bon contre-exemple : même aller dormir ou partir mourir peuvent devenir des problèmes qui nous retiennent.) Ou du moins, pourquoi certaines combinaisons de verbes nous paraissent-elles moins prégnantes que d’autres ?
Sans doute cela tient-il à nos sensibilités variables aux questions philosophiques (existentielles, métaphysiques ou éthiques). Et aussi à la culture et aux formations que nous avons reçues sur ces questions. Ou aux sollicitations que la vie nous a réservées. Mais en pratique, le plus grand étonnement n’est-il pas du côté de la construction de l’énoncé, au moment où les combinaisons de mots se font, sur la page, ou dans ce que nous appelons l’esprit ? Il semble qu’il y ait une certaine contingence (ou une facticité) dans ce processus. Au moment clé, il se pourrait bien qu’un verbe vienne à la place d’un autre, ou avant lui, et que le résultat tienne à pas grand-chose. Le jeu de combinaisons et de permutations grammaticales permet cette liberté. Du moins permet-il ici d’imaginer à chaque pas qu’un autre verbe aurait peut-être pu faire l’affaire. Mais est-ce bien sûr ? Si une proposition infinitive faite seulement de verbes (qui ne renvoient à aucun référent matériel ou tangible) prend sens pour nous et nous interroge, n’est-ce pas qu’elle se raccroche à quelque être immatériel qui la guide ? Faut-il qu’il y ait un tel être dans le ciel de nos pensées ou dans la caverne de nos idées ?
De ces questions est née l’envie de remettre en page les questions de Philosophie infinitive de sorte à en souligner davantage la fragilité. Non seulement pointer le peu de moyens qui leur sont nécessaires (cinquante verbes tout au plus, combinés avec une poignée de conjonctions), mais envie de noter leur peu de consistance, la fragile existence des questions que nous nous posons et qui nous interrogent. Envie d’une forme au plus proche de la matière des verbes (fluides matériaux de construction), au plus proche aussi de ce qui se passe lors de la composition. Une forme qui restitue le processus de construction (qui en rende les hésitations visibles) et qui porte la lecture à le rejouer (c’est-à-dire à envisager d’autres dispositions possibles). Une notation qui laisse la pensée plus libre d’imaginer se former autrement, et plus à même de percevoir la contingence et l’inconsistance de ce qui s’est écrit derrière elle. « Voilà ce qui s’est choisi, c’est tout ! D’autres choix étaient possibles, semblaient possibles, bien que ce soit cet énoncé qui ait paru le plus pertinent. »
Autrement dit, reprendre le texte dans une forme qui demanderait en elle-même : Qu’est-ce que la philosophie ? Une inclination vers un verbe ou un autre ? À quoi cela tient-il ! Et pourquoi faire cela ? Dans les questions en jeu – on l’aperçoit et on y reviendra –, le fond et la forme semblent profondément solidaires et jouer chacun l’un sur l’autre.
Pour cela, il fallait plus d’air aussi, renoncer à la compacité !
inconsister s’appuyer dessus (TIP, chapitre 2)
De là un essai ou plutôt des essais, début 2017, à partir du texte de Philosophie infinitive. Chaque morceau de Philosophie infinitive, bien présenté sur une petite page attitrée, à la façon des poèmes. Les verbes à nu, sans majuscules, sans ponctuation, disposés en vers coupés là où reprendre souffle. Avec un peu de blanc de la page entre et autour, pour respirer, avant de tourner la page. Et les quelques petites pages d’une même suite reliées en un mini-livre, type recueil de poèmes, au format A6 (une feuille pliée en quatre). Je vous en montre quelques exemplaires…
Comme chacun des quatre livres de Philosophie infinitive est fait de 6 x 9 : cinquante-quatre suites, une telle remise en page devait aboutir à près de 220 mini-livres tout légers, rapides à lire, incisifs, avec grande souplesse de passage de l’un à l’autre et multiplication des enchaînements possibles. Magnifique ! Mais contraire à l’économie de l’infinitif et impubliable en l’état. Quel éditeur se lancerait dans un tel projet ? En pratique, l’idée s’éloignait de la proposition de ramasser toute la philosophie en un volume de verbes qui tienne en poche.
De passage à Marseille en août de la même année, j’ai montré ces exemplaires à Éric Pesty, que je sais amateur de formes nouvelles. De notre discussion, est née la conclusion que, pour explorer l’idée plus avant, plutôt que de remettre en forme des textes déjà écrits de façon à restituer le processus de leur composition passée, il faudrait composer un nouveau texte en en rendant le processus et la contingence directement sensibles sur la page. Mon idée était de l’écrire en prêtant attention à l’incertitude et en la marquant au sein du blanc de la page, dans la disposition et dans l’espacement des verbes et du silence entre eux. Des traits plus ou moins brefs, plus ou moins discontinus, et du blanc, du silence. (Accepter les flexions dans la construction et les ouvertures que donne la liberté combinatoire aux points de flexion.) Suivre la forme qui se cherche, pas seulement la plier au fond. Et pour celui-ci, pour le fond, poser les questions de choix, de liberté et d’évasion.
Je ne manquais pas de questions qui ne se sentaient pas de liens définis avec un “être” prédéterminé à exprimer, et qui attendaient de se déplier dans toute leur fragilité.
1 1
habiter où
n’avoir ni où se réfugier
ni où se blottir
sans parler de demeurer
Partir des verbes. Un verbe posé, à l’infinitif, par exemple nommer, en appelle un autre, mais lequel ? et à quel mode ?, par exemple au participe présent – en passant– et où le poser ? En avant, en arrière ? Sur la même ligne, sur la suivante ? Cela dépend de leurs affinités. – En l’occurrence, en arrière et sur une autre ligne : nommer/en passant– Une ébauche de vers qui donne déjà à penser et qui appelle à terminer le vers à 9 pieds – nommer/en passant/sans y penser. Mais aussi une ébauche de forme graphique qui attend d’être poursuivie dans la page et qui appelle d’autres verbes et d’autres vers. Des verbes se proposent, parfois se précipitent en grand désordre. Certains sont retenus. Pensée qui s’avance à tâtons ? Ou forme qui se cherche, en infléchissant l’ordonnancement selon ses lignes de force ? La forme guide le fond autant que le fond guide la forme.
3 4
nommer
en passant
sans y penser
en parlant
sans s’en apercevoir
et déjà se laisser entraîner
nommer et déjà se laisser faire
On peut aussi lire en suivant la verticale centrale : nommer, sans y penser, sans s’en apercevoir, se laisser entraîner, se laisser faire.
Il fallait marquer l’incertitude dans l’avancée d’un verbe à l’autre et dans le déchiffrage. Comme au passage d’un gué, où l’on hésite à mettre le pied sur une pierre ou l’autre et où l’on essaie de calculer où l’on mettra le pied suivant : car ce n’est pas tout de poser un pied sur une pierre : on se trouve pris dans une dynamique, l’élan ne permettra pas de revenir en arrière ni de s’arrêter, il faut pouvoir poser l’autre pied rapidement, si l’on ne veut pas tomber à l’eau. Une fois la configuration verbale dessinée, une fois la rivière franchie, changement de page, pour une autre question.
Le livre s’est écrit à l’automne 2017, il y a quatre ans. Il s’est composé de 36 morceaux graphiques. Bien que cela n’ait pas été prémédité, les motifs dessinés rappellent ceux que, dans 36 morceaux, il s’était agi de relever à la surface de la mer en convoquant plusieurs instruments (plume, compas, crayon) pour tenter de saisir l’insaisissable ou le laisser échapper. Les traits sont devenus ici des lignes de verbes conjoints, mais la question de fond est la même. Est-ce donc l’insaisissable qui donne la partition et nous qui devons nous en faire les interprètes, comme le demandait Mer à faire ? Où trouver la partition d’être et de vivre et quelle forme lui donner ? Est-ce à nous de la composer avec les verbes et les traits les plus légers/les plus ouverts possible ? Ou bien avons-nous seulement à les laisser se composer et à les déchiffrer ou à les interpréter – les conjuguer – au gré des pronoms et des noms, des êtres et des choses ou des circonstances que nous rencontrons ?
Tractatus infinitivo-poeticus est un traité de ces questions, mais un traité qui ne veut rien résoudre, qui montre seulement des formes qu’être et vivre nous amènent à prendre de gué en gué, les morceaux que les éléments de construction (traits ou verbes) dessinent sur la page dès lors qu’on les laisse s’assembler et enfanter les sujets sans les contraindre à des objets et des formes prédéfinis.
Le livre s’interroge sur la langue et l’endroit où nous pourrions habiter. Sur le faux abri que nous trouvons dans la nomination, sur l’errance et l’incertitude dont nous pouvons nous angoisser, et sur le nomadisme ou le mouvement où nous pouvons accepter de nous épanouir. Notre travail à nous (l’éternel travail de la littérature, poésie, philosophie… ?) est de mettre le doigt aussi précisément que possible sur ce qui fait problème : trouver les bons verbes, les bons mots et non donner des solutions ! Ou plutôt la solution est de donner la bonne formulation, de “bien” former/formuler.
1 1 (fin)
ne rien avoir n’avoir jamais pu que courir
aller
de vivre à penser
de penser à vivre
 Composition de être à être
Composition de être à être
— Dans être à être, vous abordez les questions d’être et de vivre non plus en composant des propositions nouvelles, mais en transcrivant en verbes des textes classiques de la philosophie sur la question de l’être. Vous aviez déjà exploré cette méthode de transcription infinitive dans L’infinitif des pensées (Éditions de l’éclat, 2000), il semblait qu’à l’issue de leur infinitisation, il ne restait rien des textes d’Aristote, Kant ou Heidegger. Quel chemin vous a conduit à reprendre la question de l’être, à relire les grands auteurs et à sortir des verbes pour explorer, en quelque sorte de l’extérieur, le mode de penser infinitif ?
Tout de même, être, vivre, penser, philosopher, cela ne peut pas être que cela : que des verbes ! Pas de sujet, pas d’objet complément ! Une sorte de mathématique abstraite ou de composition esthétique ! Et le concret, le réel, l’être, que sont-ils ? Sont-ils, ou ne sont-ils pas ? Et l’Autre, comment aller vers lui, vers vous ? Et tout ce qui s’est dit de l’Être et de l’Autre ? Si les substantifs, en disant d’avance le réel, sont condamnés à le manquer, l’infinitif, à l’inverse, du fait même de ses dispositions initiales, ne va-t-il pas trop loin dans la retenue ? Ne se voue-t-il pas d’avance, lui, à laisser mystérieux le réel, l’autre, l’être, l’essentiel ? La langue infinitive rend-elle caduque la question de l’être ou, au contraire, la manque-t-elle d’emblée ? À l’inverse, la langue des noms masque-t-elle l’être ou lui est-elle nécessaire ? Ce sont ces questions qu’explore être à être.
Il fallait reprendre la mer, s’enfoncer plus loin dans le passage, poursuivre l’exploration, lancer une nouvelle expédition, partir à la recherche de l’île suivante. (Revenir sur Penser à être/à croire/à penser/à vivre, de même que, Croire devoir penser, tout en verbes également, avait suscité l’écriture de L’infinitif des pensées, ou qu’ensuite, dans un autre domino, 36 morceaux, tout en traits, avait appelé l’écriture de Mer à faire. Être à être en est le pendant pour le quatuor. Voilà ce qui arrive quand on essaie de se taire ou de retenir. Une autre parole veut revenir.)
Le besoin était d’effectuer un retour critique sur la méthode infinitive, un regard distancié sur ce qu’elle avait accompli, mais aussi une ultime tentative d’aller au bout d’elle-même et de ce qu’elle peut apporter de clarification et de rafraichissement à la réflexion lorsque celle-ci tend à s’embarrasser, se biaiser ou simplement trop s’échauffer. Il fallait approfondir encore, et pas de fond plus fondateur que la question de l’Être. La méthode infinitive se confronte à cette question dans être à être, en la transportant d’île en île, d’année en année, de carnet en carnet, dans une suite de transcriptions infinitives, de Platon à Kant, des Méditations métaphysiques de Descartes aux Méditations cartésiennes de Husserl, de Être et temps de Heidegger à Autrement qu’être de Levinas.
Plutôt que d’écrire des propositions de réflexion et d’interrogation nouvelles comme dans Penser à être et dans Tractatus, l’entreprise ici est de transcrire en verbes les propositions philosophiques qui structurent nos conceptions de ce qui est. Réinvestir par les verbes de grands textes de la métaphysique pour tenter de faire apparaître d’une part ce que la question de l’Être mais aussi la question de l’Autre doivent à la nomination, et d’autre part ce que ces textes doivent aux verbes qui travaillent dessous et aux opérations qui les ont orientés.
Que deviennent les philosophies qui se sont échafaudées à coup de concepts, d’idées et de notions, si on les détache ainsi de leurs attaches prédéfinies et qu’on les renvoie à leurs suppositions ? En s’appuyant sur tel ou tel nom, à quelles opérations les textes initiaux procèdent-ils et engagent-ils ? Et pourquoi ? Quelles façons d’être, quels verbes travaillent sous ces choix non exprimés, parfois inconscients ou automatiques ? Par quelles propositions infinitives expliciter ces positionnements implicites ? Que mettons-nous dans nos noms et nos notions ordinaires ? Comment cherchons-nous à être en en passant par eux ? (être à être, p. 24)
Écoutons Spinoza, dans l’Éthique, et l’un de ses devenirs infinitifs possibles :
Par cause de soi j’entends ce dont l’essence enveloppe l’existence, c’est-à-dire ce dont la nature ne peut être conçue que comme existante. […] De tout ce qui peut être conçu comme non existant, l’essence n’enveloppe pas l’existence.
Être en se causant : s’engager à exister (et ne pouvoir se concevoir sans exister). Ou bien, être sans s’engager à exister (pouvant se concevoir comme n’existant pas). (être à être, p. 61-62)
Vous entendez : il ne reste rien du texte original. Sans leur langage, Spinoza et Heidegger ne sont plus Spinoza et Heidegger, nous ne les retrouvons pas. Mais vous entendez aussi ce qui se cherche dans le passage à l’infinitif. Il s’agit non seulement de faire apparaître les verbes et les opérations qui nous travaillent quand nous cherchons à nous représenter les choses, mais de libérer ces verbes et ces opérations – être, s’engager–, de les laisser dire et simultanément de nous libérer par la distance et l’engagement qu’ils permettent. Laisser dire les textes fondateurs ; les écouter, sensiblement modifiés ; voir ce qu’ils gagnent à passer tout en verbes et, de là, nous engager ou non à opérer leurs propositions.
Tel est le projet : Repartons d’où nos prédécesseurs sont partis, mais d’un autre pied, dans une langue où tout ne soit pas dit d’avance. Reprenons les questions là où ils les ont laissées, et reposons-les d’une manière qui nous sollicite et nous interroge directement. Non pour redire ce qu’ils ont dit, mais pour faire dire à leurs textes ce qu’un allègement permet d’apercevoir ou de provoquer, qui ne se laissait pas voir ou ne se mettait pas en branle jusque-là. Faisons comme si tout n’était pas fini pour nous, pas déterminé, pas arrêté, comme si nous pouvions être rendus à l’acte de dire et d’être.
La méthode revient à supposer que les textes transcrits ne sont pas clos : ils réserveraient des possibilités qui pourraient être développées au-delà de ce qu’eux-mêmes ont dit, autre chose parfois que ce qu’ils ont voulu dire. Ces textes resteraient à être, à dire, à faire. Il y aurait des possibilités infinitives platoniciennes, cartésiennes, kantiennes, nietzschéennes, husserliennes, heideggériennes, wittgensteiniennes. Nous pourrions être et vivre comme ils le disent, ou plutôt comme ils y invitent. (être à être, p. 27)
C’est ce qui arrive lorsqu’on prend le parti des verbes, ils portent à l’action et à une action toujours à faire, alors que les philosophies du sujet, de l’être et de l’état poussent à l’acceptation et à la soumission. Nietzsche qui l’a aperçu accuse pourtant : « c’est la morale qui… », « ce sont les prêtres qui… », mais la morale, les prêtres, c’est possiblement nous, nous qui les pensons. L’usage des substantifs déresponsabilise et paradoxalement désengage les sujets désignés, les effacent, là où des sujets innommés pourraient se projeter dans l’action et s’investir.
De fait, la transcription déplace la question de l’Être (le nom), indéfinissable, inatteignable, sous laquelle la philosophie a cru devoir s’abriter, vers la question autrement vivante qui est d’être (le verbe), question à la fois plus large et plus proche de nos aspirations ordinaires, avec ses ramifications en mille interrogations, physiques ou métaphysiques, mais aussi existentielles ou éthiques.
Relisons à ce propos Être et temps de Heidegger. Il est possible qu’une transcription infinitive permette de prendre un raccourci épouvantable et d’aller directement non pas à l’essentiel mais dans le sens de ce que l’ouvrage cherche par la suite avec force concepts et distinctions qui, d’un point de vue infinitif, entravent son avancée, peut-être à son corps défendant (l’Être, l’étant, l’être-là, être-le-Là de l’être). Jargon pour jargon (paradoxe de la langue infinitive qui apparaît comme un jargon du seul fait qu’elle n’emploie aucun jargon, tant nous sommes habitués à user de mots qui nous dépassent), écoutons une interprétation infinitive possible de la pensée de Heidegger :
Ne pas comprendre être en le cernant, mais en étant, en y allant d’être : s’agir d’être, se concerner d’être : comprendre se rapporter à être, et à être comme interroger (et non comme étant et à saisir). (être à être, p. 120-121)
Même si la question de l’Être (posée sous nom à majuscule) cherche à dépasser ou à transcender nos questions particulières, elle ne saisit qu’une version dérivée, embarrassée et policée de la question d’être, qui préoccupe nos existences.
Plutôt que l’Être, n’est-ce pas être qui mérite d’être rétabli en sujet d’interrogation et d’hypothèse ? Ce qui importe à nos vies et à nos fins, ne renvoie-t-il pas avant tout à la “présence”que nous mettons dans nos réponses à ce qui nous sollicite ? Peut-être que la question qui nous interpelle ne se tient pas du côté des noms, mais de celui des verbes et plus encore de l’investissement mis en eux. Peut-être qu’elle n’est pas de penser l’être, ni de parler de l’être, ni même de parler d’être, mais d’être, au-delà des mots, d’aimer, de désirer, de dessiner, de chanter… de s’occuper d’elle, de lui, d’eux…
En ce cas, il faudrait ancrer être en vivre, et vivre en être. Attacher la question d’être (la nécessité de cette question) à celle de vivre (à la question du sens, du ton ou du tour à donner à la vie). Lier et mêler délibérément la métaphysique à l’éthique. Affronter les questions ensemble : être, exister, et répondre de la forme ou du sens à donner simultanément à nos existences et à nos vies. (…) Comment être, comment nous fonder, comment nous former ? Et en même temps comment nous orienter, comment nous comporter, comment vivre ? (être à être, p. 22-23)
L’étude de la question d’être met aux prises avec celle de n’être pas, c’est-à-dire avec les possibilités de ne pas être et de ne pas vivre (en dépit des apparences), ou de ne rien être et de ne rien vivre. De Parménide et Platon à Wittgenstein, en passant par Leibniz et Bergson, plusieurs textes transcrits à l’infinitif dans être à être cherchent à ouvrir effectivement ces possibilités, que Tractatus infinitivo-poeticus marque dans le blanc de ses pages, dans le silence entre les verbes. Peut-être ne sommes-nous pas et ne pensons-nous pas, ou du moins pas tout à fait, pas vraiment, pas encore, et sans rien d’acquis. Telle est l’hypothèse, la quête ou le “risque” de l’infinitif. Qu’il resterait à faire. Que ça/la vie/les choses ne seraient pas sans que nous ne le/la/les fassions. Que nous ferions pour être, pour penser et pour vivre. Que nous serions pris dans un mouvement perpétuel. Il ne manque pas de forces adverses ou négatrices pour nous le rappeler.
Évidemment, cela paraît contre-intuitif. La thèse adverse est plus facile à admettre : que les choses soient/que nous soyons sans rien faire. La forme, la grammaire que nous avons entre les mains nous pousse à cette hypothèse simple (et peut-être que la grammaire est faite pour nous simplifier la vie) : que nous sommes avant même de nous mettre à faire quelque chose, et qu’il faut bien que nous soyons pour faire (cf. St-Augustin ou Descartes : pas de faire, pas de penser sans être). Alors, tout serait dit. Nous serions, et déterminés. Notre destin serait, celé à plus ou moins longue échéance. Nos vies arrêtées.
Mais n’est-ce pas un préjugé ou du moins une certaine façon de voir ? Comment le savoir ? Admettre que nous avons à faire pour savoir. Et donc accepter de mettre en forme ou de déformer. De ne pas savoir “purement”, mais de chercher à savoir, “en conscience”…
Se mettre en mode infinitif exploratoire ou expérimental, se mettre du côté du faire, c’est au moins faire être les choses en prenant des points de vue sur elles (même si elles n’existent pas hors de ces points de vue), et c’est se procurer le sentiment d’être, à travers celui de faire ou de penser (c’est s’en donner des preuves par nos activités et leurs produits), mais c’est aussi prendre le risque que « ça ne se fasse pas », que ça ne marche pas, que ça rate, accepter la possibilité de ne pas être, de manquer : précieuses possibilités inaccessibles aux philosophies substantives. À ce sujet, peut-être pourrait-on transcrire Platon en noms sans verbes, puis l’inverse :
Or des noms seuls, énoncés de suite, ne forment jamais un discours, non plus que des verbes énoncés sans noms. (Le Sophiste)
Pas de discours dans un énoncé de noms,
non plus qu’avec des verbes à part de tout nom.
Or ne jamais parvenir à discourir en ne faisant que nommer et nommer… non plus qu’en verbant sans dénommer (être à être, p. 126).
Philosophie ou poésie ?
— Tractatus infinitivo-poeticus se présente comme un livre de poésie prenant des questions de philosophie pour objets, et être à être comme un livre de philosophie de forme atypique, une sorte de poésie en prose, qui commence par une transcription du poète Tristan Corbière. Pourriez-vous revenir sur ces cheminements en eaux incertaines et sur ce qu’ils nous disent de l’entreprise que vous énoncez en tête du Tractatus :« rouvrir les très vieilles et toujours très vivaces questions des rapports de la logique et de la grammaire d’une part, de la philosophie et de la poésie d’autre part » ? Comment les deux livres ont-ils évolué pour prendre leurs formes finales ?
Être à être est parti comme un doigt de plus, un pouce opposé aux quatre frères Penser à être, à croire, à penser, à vivre, et différent d’eux. Sous une autre forme, mais préoccupée elle aussi de ne pas se laisser piéger par ce qui se dit. La forme de être à être reprend celle de L’infinitif des pensées, sautillante, jamais immobile, changeante d’un morceau à l’autre, alternant rapidement styles et tons, pastiches et journaux intimes, réponses et objections, au gré de mes propres déplacements d’île en île, de lieu en lieu, de paysage en paysage. Le projet fut un temps celui de préludes et fugues, mais ce sont finalement douze suites et fantaisies. Douze transcriptions à l’infinitif et méditations à leur sujet, entrecoupées d’autant de pseudo-tentatives de théorisation et d’essais d’ontologie. Il fallait un peu d’ironie pour ne pas enfermer la quête. Voltaire a aidé.
Le gros de être à être s’est écrit durant les quatre années 2014 à 2017. D’abord Descartes, Kant, Nietzsche, Husserl à Roscoff et Batz en 2014. Puis retour à Platon à Ouessant, et de là, Heidegger en Crète en 2015, Levinas dans les îles éoliennes en 2016. Puis de nouveau Platon à Ouessant, mais cette fois vers Leibniz, Spinoza, Bergson et enfin Wittgenstein, fin 2017, en même temps que se terminait le Tractatus. Non sans nombreuses récritures, transformations, inversions, recyclages, essais de montage, renvois, raccords, reprises…
En chemin, le projet non très défini à l’origine – Pensez ! : l’être ! Être ! Rien ! rien moins que cela ! – s’est précisé et simplifié. Une partie, écrite à Venise en avril 2014 et qui consistait à se distancier de l’écriture infinitive par une écriture substantive, toute en noms, s’est détachée pour constituer un livre à part, La Comédie des noms, publié en 2016 par Éric Pesty. Elle a été remplacée par la fantaisie n°12. Des transcriptions à l’infinitif de Guillaume d’Ockham, effectuées fin 2016-début 2017, se sont également séparées de être à être– mais pour des raisons de forme – sous le titre Minimal nominal, en attente d’édition.
Après le travail de gros œuvre, est venu, pour les deux livres, le temps des retouches, non aussi visibles que la composition initiale, mais cruciales pour affiner le ton, le tir. Pour le Tractatus, la principale révision a consisté à enlever en mars 2018 les notes sur le texte, qui venaient initialement en fin d’ouvrage et qui constituaient des compléments ou des résidus de 24 des 36 chapitres/poèmes. Des vers qui n’avaient pas trouvé de place dans les formes graphiques et qui en avaient été écartés. Éric trouvait contraire à la structure très géométrique du livre en 6 parties de 6 morceaux, qu’il ne se termine pas nettement et qu’il se prolonge par une sorte d’annexe.
Bien que les vers constituant ces notes n’aient pas réussi à entrer dans la cohérence formelle des morceaux où ils s’étaient engendrés, ils faisaient néanmoins partie de ceux-ci. Il aurait été injuste, me semblait-il, de les abandonner purement et simplement. La solution est venue d’Éric qui a suggéré de les monter en exergue de leurs chapitres/poèmes d’origine, et de les imprimer dans une encre brune, un peu pâle, qui permette de les maintenir à une certaine distance. L’impression a finalement pu se faire en typographie sur la presse d’Éric, dans son atelier de la rue des Belles Écuelles à Marseille, en mai dernier.
Pour être à être, les révisions se sont faites en 2019, avec écriture des fantaisies n°4, n°7 et n°12, puis début 2020 reprise de l’ordre des parties et nombreuses petites retouches, de-ci de-là, et enfin ajout de la Lettre aux inexistantsen août 2020, sous le coup d’une envie nouvelle et en perspective de la publication annoncée par Michel Valensi, mais aussi en anticipation de sa demande d’une sorte de préface. Michel a toujours grand souci des lecteurs et de leur réception des ouvrages.
Comme vous le voyez, le délai entre la fin du gros œuvre des deux livres en 2017 et leur publication en livres maintenant a été, pour l’un comme pour l’autre, l’occasion d’une maturation profitable. L’occasion aussi de se rencontrer pour constituer un diptyque qui n’avait pas été planifié comme tel et qui doit une partie de son existence aux impératifs des calendriers éditoriaux, même si les deux textes proviennent d’un même chaudron de questions sur êtreet sur vivre. Des questions “de fond” donc, mais des questions de quoi ? : de philosophie ? (de métaphysique ? d’éthique ?) ou bien de poésie ? La forme, qui serait le domaine de la poésie, n’est-elle pas essentielle au fond, à ce que peuvent devenir être et vivre ? N’est-elle pas déjà être et vivre, ne serait-ce que par les choix qui s’y opèrent ? Outre la confrontation aux pères, ce sont ces questions qui nouent le diptyque en tant que tel.
À première vue, le diptyque est constitué d’un volet poétique et d’un volet philosophique, chacun double de l’autre. Mais ce n’est pas si simple. Certes, l’un est publié par un éditeur de poésie, et l’autre par un éditeur de philosophie, mais chacun de ces éditeurs a fait des incartades hors de son territoire. Alors, qu’en disent d’autres éditeurs ? Les premiers auxquels je me suis adressé, avant d’avoir la chance de rencontrer Michel et Éric, refusaient mes manuscrits au prétexte notamment que les libraires ne sauraient pas sur quelle table ou dans quel rayonnage les ranger. Heureusement mes ouvrages ont rencontré des libraires qui n’étaient pas obsédés par les rangements et les classements, et qui ont trouvé intéressante justement l’occasion donnée de se redemander pourquoi on aurait voulu distinguer et séparer.
Alors, poésie ou philosophie ? Qu’en disent les philosophes universitaires ? Ils ont comme habitude de reléguer mes ouvrages en poésie, tant ils diffèrent de leurs méthodes savantes. Seulement, cette fois j’ai pris les devants en barrant l’issue : si le Tractatus est de la poésie, alors être à être qui en diffère n’en est pas, n’est-ce pas ? Dès lors, dans quelles spécialités les classer et les enfermer, ces ouvrages qui ne veulent que courir ? Philosophie du langage ? Il me semble que ce n’est pas cela, qu’ils ne cherchent pas à dire ce que fait le langage ou ce qu’il devrait faire, mais qu’ils reconnaissent seulement la nécessité de prendre soin du langage, notammentde celui de la philosophie. (Entre autres, de celui qu’elle emploie pour penser au langage (comment penser à dire ?), mais prendre soin aussi des langages qu’elle met en œuvre pour penser à l’esprit, au cerveau, aux sciences, à la métaphysique, à l’éthique, à la liberté… Et ainsi, se donner des outils pour réenvisager et libérer.)
Une philosophie qui ne se soucierait que de fond, de concepts, d’idées, de représentations, de théories… et pas de sa forme, serait emportée par celle-ci sans s’en rendre compte : la forme irréfléchie déterminerait le fond, concevrait pour nous, à notre place. De même, une poésie qui ne se soucierait que de forme, de moyens, d’images, d’effets ou d’associations… et pas de son fond serait emportée par celui-ci : le fond inanalysé formerait pour nous, déterminerait à notre place les formes que nous rechercherions.
En poésie comme en philosophie, la simple manipulation formelle ou conceptuelle n’aboutit qu’à révéler les lieux communs que disent déjà nos préjugés, nos idées toutes faites. Elle manque ce qu’on peut appeler, selon les cas, le réel, l’autre, l’être, le mystère, l’infini, la transcendance, ou bien le désir, ce vers quoi se tendent nos noms et nos verbes. Mais “cela”, vers quoi nous nous tendons et que nous plaçons en position de dépasser l’idée que nous pourrions en avoir, nous pouvons préférer ne pas le nommer, le laisser non dit, indicible, innommable, pour ne pas l’abimer, si tel est notre vœu secret.
Ou bien, pour ne pas retomber dans le piège d’une réification sournoise (ou d’une déification), nous pouvons aussi ne même pas laisser entendre quoi que ce soit, et simplement remarquer que nos inévitables manipulations, nos incorrigibles actions, nos verbes de vivants, aussi réfléchis soient-ils, courent toujours le risque de manquer ou de laisser échapper, sans avoir nécessairement à déterminer quoi. Simplement nous mettre en position de ne pas connaître et de ne pas comprendre afin de pouvoir éventuellement rencontrer.
On en revient à la question première : comment ouvrir et s’ouvrir sans enfermer et sans s’enfermer en formant ? Car il ne s’agit pas de se fermer à former, mais seulement d’éviter d’enfermer, nier ou exclure : d’échapper à la tyrannie du déjà Vu, du Su, du Même. Eh bien, si nous sommes et si nous vivons, formons ! mais en ayant un œil sur les verbes à la manœuvre. (Contournons les chosifications en infinitivant, déroutons les identifications en déformant ou en déplaçant, déjouons les exclusions en transposant.) Formons et aussitôt reformons autrement. En acceptant de voir échapper sans pouvoir définir ni saisir, et en ayant à recommencer. Autrement dit, en acceptant d’être sans pouvoir se reposer sur être.
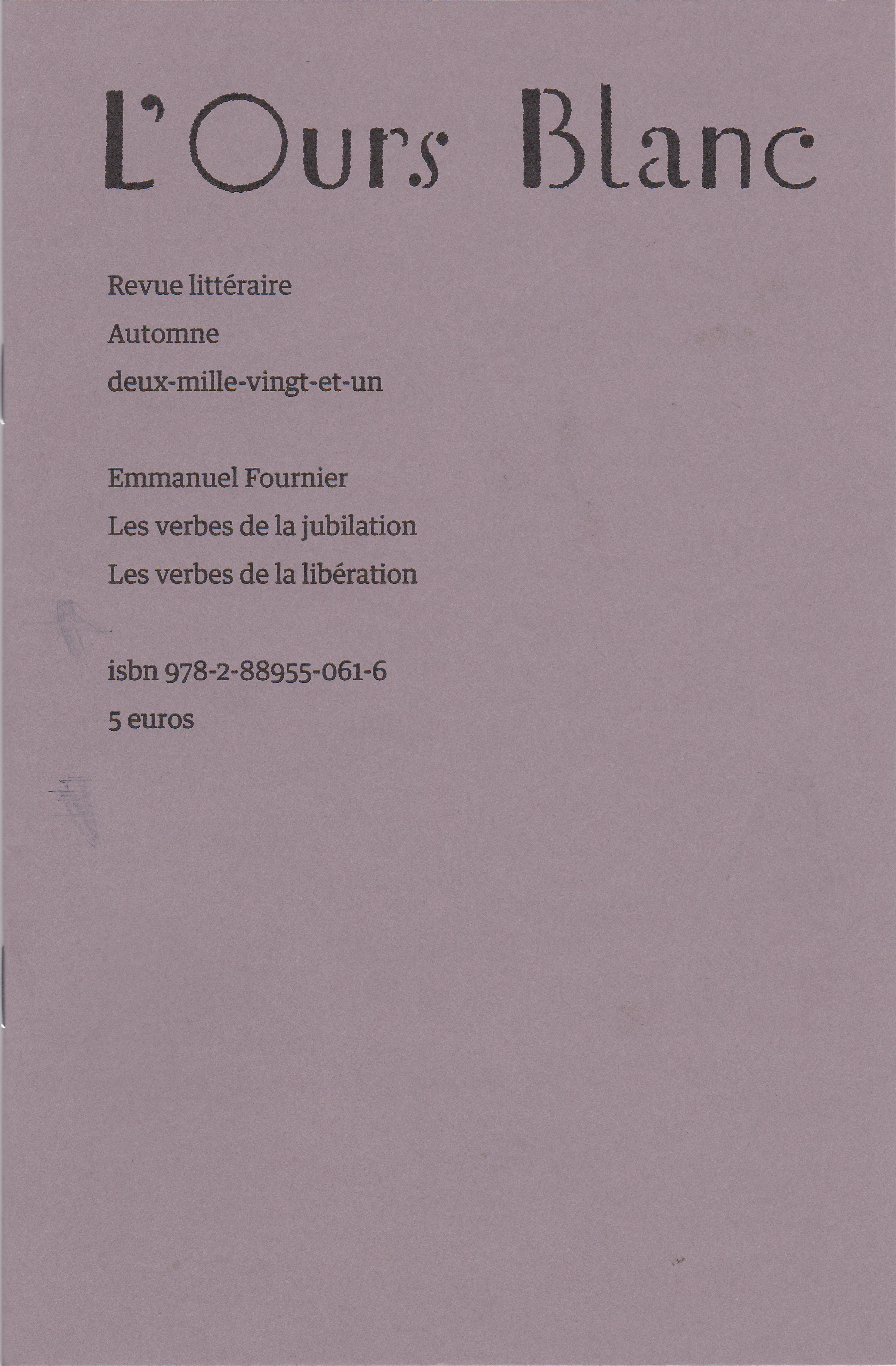 Complément – Les verbes de la jubilation et de la libération
Complément – Les verbes de la jubilation et de la libération
— À côté de la méthode infinitive, vous explorez d’autres méthodes, d’autres “langues de libération”. Parait cette semaine un troisième livre, un autre diptyque à lui tout seul, intitulé Les verbes de la jubilation/Les verbes de la libération (éditions Héros-Limite, L’Ours blanc). Pouvez-vous pour conclure nous dire quelques mots des rapports de ce nouveau diptyque à celui dont nous avons parlé ?
Parallèlement à l’exploration des possibilités qu’ouvre la langue de recherche principale, infinitive – et par souci de ne pas s’enfermer dans celle-ci ou par envie d’explorer autrement –, d’autres méthodes sont à l’épreuve dans mon laboratoire/atelier. Nous avons dit un mot de l’écriture itinérante ou ambulante (expérimentée dans L’infinitif des pensées et dans être à être) et de l’écriture nominale ou substantive(à l’essai dans La Comédie des noms et dans la fantaisie n°12 de être à être). Celle-ci consiste à formuler une pensée sans verbes. Elle fait partie des méthodes de composition pour peu d’instruments, en l’occurrence pour les noms. C’est-à-dire une méthode en miroir de l’écriture infinitivepour verbes seuls, en se passant des noms.
La transposition est une autre méthode, expérimentée initialement au sein de L’infinitif des pensées (L’hugolienne, selon L’homme qui rit de Victor Hugo, p. 131-133), puis dans deux petits livres, Les verbes de la désolation et Les verbes de la consolation, parus en diptyque aux éditions contrat maint en 2012. Les verbes de la jubilation et Les verbes de la libération, publiés sous la direction de Hervé Laurent, viennent compléter un nouveau quatuor.
La méthode répond au même souci que les autres : ne pas piéger les chosesdans la parole dont on en parle, ne pas se laisser piéger (notamment par les rôles que nous donnons aux noms), mais au contraire libérer des possibilités et se libérer. Seulement, le procédé est différent. Chacun des quatre textes est un collage de morceaux “préparés”, c’est-à-dire transposés à partir de textes dont quelques mots-clés indicateurs de domaine sont remplacés par les mots philosophie ou infinitif. De la même façon que John Cage “préparait” son piano pour explorer des possibilités nouvelles. Le Gai savoir de Nietzsche est ainsi préparé et collé avec Roland Barthes par Roland Barthes dans Les verbes de la jubilation. Notre-Dame de Paris de Victor Hugo est accouplé avec Léonard et les philosophes de Paul Valéry dans Les verbes de la libération.
Le verbe m’emporte selon cette idée que je vais faire quelque chose avec lui : c’est le frémissement d’un faire futur, quelque chose comme un appétit. L’infinitif est une fête succédant à une longue période de privation et d’impuissance, la jubilation des forces recouvrées, de la foi réveillée en un lendemain et un surlendemain, le sentiment et le pressentiment soudains de l’avenir, de nouvelles aventures, de mers à nouveau ouvertes, de buts à nouveau permis, à nouveau dignes de foi. (Barthes-Nietzsche, VDJ, p.7)
Ces textes, non nécessairement de philosophie, se trouvent détournés de leur domaine initial pour dire ce qu’est le travail de la philosophie, notamment de la philosophie infinitive, ce qu’elle fait, ce qu’elle cherche. Ils composent finalement la Théorie des verbes que je me suis toujours refusé à écrire, par principe, afin de ne pas dire à la philosophie ce qu’elle est et ce qu’elle a à faire. (« Qu’est-ce qu’il ne faut pas faire pour s’ouvrir des échappées ! » Heureusement, il y a bien des manières de peindre, dont aucune n’enlève la possibilité de peindre autrement.) Autrement dit, la méthode de transposition-collage est une méthode pour théoriser sans théoriser, ou du moins sans dogmatiser.
Mais celle-ci est aussi une pratique de coucou ! Immorale : me poser dans le nid/le texte d’un autre, balancer par-dessus bord quelques-uns de ses œufs/de ses noms, mettre mes objets problématiques à la place et laisser l’auteur premier couver ma théorie pendant que je vole et verbe plus loin. Non éthique, mais ça marche ! Dans ces quatre textes, ce sont huit auteurs qui s’associent pour m’écrire, à peu de frais, de belles pages d’explication de l’infinitif, des pages que jamais je n’aurais voulu concevoir ni pu écrire aussi bien qu’ils ne le font. Pourquoi redire ce qui a déjà été très bien dit ?
Ce qui est étonnant, ce sont surtout les possibilités de transfert d’intuition d’un domaine à l’autre, que le procédé révèle et libère ! N’est-ce pas un peu cela philosopher ? Nos langues en disent bien plus que ce que nous entendons en les prenant au pied de la lettre. La transposition-collage invite, comme la transcription infinitive, à relire d’un œil neuf les auteurs passés et à découvrir au sein de leurs textes des possibilités de lecture et d’association que ne soupçonnaient pas nos regards préformés ou trop contraints.
Il est clair à la fin que faire une théorie de l’infinitif et de la philosophie ou de l’être n’est pas l’objectif principal. Ces mots ne sont que les motifs de l’essai (des objets puisqu’il en faut et que nos habitudes de grammaire, en tout cas, l’attendent), des sortes de jokers, des cartes blanches qui prennent la valeur qu’on veut. L’objectif dernier est de s’interroger sur ce qui est là-dessous ou là-dedans, si tant est qu’il y ait quoi que ce soit. Bref, de s’interroger, de philosopher, d’être et de vivre, de trouver comment. Et comment libérer.