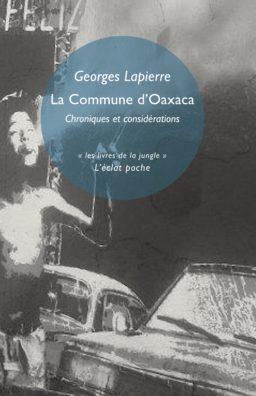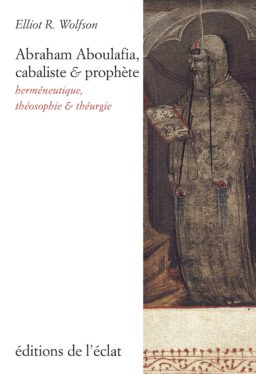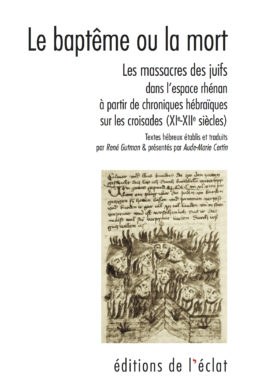« La poésie de Leandro Calle » par Yves Roullière
J’ai connu Leandro Calle il y a vingt-cinq ans, alors qu’il était doctorant ou post-doctorant en Lettres à Paris. Un ami commun, poète espagnol, m’avait parlé avec admiration d’un poème sous forme de chemin de croix que Leandro était en train d’achever et qui s’appellera finalement Une lumière venue du fleuve, le premier du recueil Passer et autres poèmes. Piqué par la curiosité, j’ai contacté Leandro pour lire cette suite poétique. Et il a accepté tout en me faisant part de ses doutes et de ses angoisses sur ces vers qui semblaient lui échapper. Il faut dire que le poète se met dans la peau d’un prisonnier qui est sur le point d’être jeté depuis un hélicoptère au large de Buenos Aires, dans le cadre de la politique de terreur de la dictature militaire argentine, pratique inspirée de celle des légionnaires français durant la Guerre d’Algérie.
Exercice éminemment risqué, et j’ai vite compris pourquoi il angoissait à ce point Leandro. En effet, ce poème fusionne au moins trois éléments difficiles à concilier : la tragédie historique de l’Argentine dont Leandro Calle a hérité (il était enfant durant la dictature), l’incarnation du poète en condamné à mort et le développement liturgique classique de la passion de Jésus Christ avant qu’il soit crucifié.
Ce qui impressionne ici, c’est que Leandro Calle met toutes ses ressources poétiques au service de ce « tombeau » paradoxal, tombeau maritime, aquatique. Il exploite différentes formes, différentes métriques, différents blancs, pour être au plus près des derniers cris, des derniers battements de cœur, des derniers silences de l’homme qui, longuement torturé au préalable, va être englouti dans cet endroit tant aimé des Argentins où se joignent le Río de la Plata et l’Atlantique. L’angoisse redouble évidemment dès lors que le poète se pose la question de sa légitimité à entrer si loin dans la chair et l’esprit d’un homme en pleine agonie. D’autant que le « modèle » de la passion de Jésus Christ ne permet pas forcément de prendre trop de distance si l’on considère celui-ci comme le Fils de Dieu… Qui suis-je pour oser me mettre dans la peau de ces deux hommes que je n’ai pas connus directement ? En faire un thème poétique n’est-il pas indécent ?
J’étais donc averti, mais cela ne m’a pas empêché d’être bouleversé par ce poème. Je me vois encore en train de le lire. Cela faisait des années que je n’avais pas été à ce point retourné par un poème. Il était évident que son auteur avait tout donné, y avait comme joué sa propre vie, tout ce qu’il y a en lui d’esprit et de matière tout uniment, de prière silencieuse, de « música callada » (comme dit Patricia Farazzi dans sa belle préface), mais aussi de nature plus ou moins indifférente au sort humain, au sort divin. Je me rappelle l’avoir lu dans les années 2000 devant un parterre de poètes au Salon de la Revue. Il régna un long silence pendant et après, et des poètes comme Pierre Oster, Jean-Pierre Lemaire, et de plus jeunes étaient venus m’exprimer leur émotion. Il avait même été question de le lire lors d’un vendredi saint dans une église parisienne mais finalement le poème avait été jugé trop violent, trop susceptible d’engendrer des malaises parmi les pénitents.
Il m’est vite apparu aussi que l’originalité de la poésie de Leandro Calle réside dans ses « suites ». Quand on choisit de traduire un poète, me semble-t-il, il faut veiller à ce que cette poésie constitue un véritable apport, une véritable nouveauté par rapport à ce qui se présente comme poétique au sein de la culture où elle est proposée à la lecture. Leandro Calle donne ainsi toute sa mesure dans les poèmes à dimension narrative, théâtrale, tragique, voire épique. Il a besoin de temps, d’étapes pour que ses visions donnent toute leur puissance évocatrice. Pour qu’elles aient une réelle portée, une portée universelle, il faut que ces visions viennent de loin, même si l’histoire, le contexte, la langue, le paysage, voire la cosmologie, peuvent apparaître très différents des nôtres.
**
Yves Roullière, né à Nantes en 1963, est poète, traducteur, essayiste et éditeur. Son premier recueil, La vie longue à venir, a paru en 2016 aux Éditions Librairie Atopia. Hispaniste, il a principalement traduit et commenté des œuvres de Lope de Vega, Miguel de Unamuno, Gabriel Miró, José Bergamín, Ricardo Paseyro, Miguel Espinosa, Ángel Bonomini, Horacio Castillo, Leandro Calle et Carolina Massola.
Introduction de Michel Valensi
« La poésie de Javier Heraud », par Patricia Farazzi