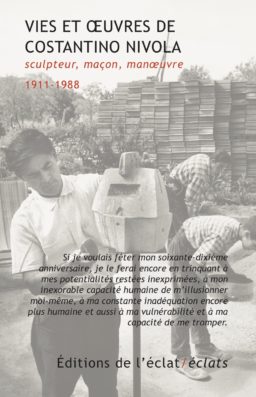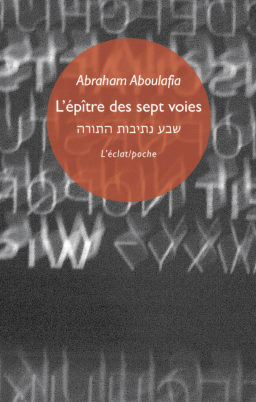* Ce discours à été prononcé par Michel Valensi le 8 juin 2017 lors de la remise de la mention honorifique des deuxièmes Rencontres philosophiques de Monaco
À mes enfants, Raphaël et Ruben, qui ont grandi à l’ombre de l’éclat
Pour ne pas faire mentir la tradition selon laquelle, même quand on ne les interroge pas, les parents méditerranéens parlent d’abord de leurs enfants en poussant de longs soupirs plaintifs et secrètement fiers, je voudrais évoquer une anecdote qui les concerne et concerne l’éducation que nous avons tenté de leur donner, piochant ici et là dans les livres les réponses (souvent inadaptées) aux questions qui surgissaient dans notre parcours difficile de jeunes parents inexpérimentés. La célèbre proposition de Spinoza selon laquelle « la récompense de la vertu c’est la vertu elle-même », par exemple, était devenue entre nous une sorte de ritournelle lancinante qui disait plus notre difficulté à les récompenser à la mesure de leurs prouesses, qu’une volonté de leur inculquer une éthique dont on pouvait être sûrs qu’ils l’auraient forgée eux-mêmes, et sans nous, au contact de la vie même.
Si bien que la proposition 42 de la cinquième partie de l’Éthique fit très tôt partie des plaisanteries qu’ils nous renvoyaient à la figure, plus pour nous signifier notre incompétence de parents apprentis philosophes que l’efficace d’une parole qui n’était pas forcément destinée à l’être.
Lorsque le plus jeune des deux eut à passer son bac, après une scolarité fougueuse à la mesure de son tempérament, il dût répondre à la question : « La perception peut-elle s’éduquer ? » et il eut la très riche idée de conclure sa dissertation par une adaptation de la proposition spinozienne, totalement hors sujet, mais qui dût sans doute tirer des larmes à l’examinateur, si bien qu’il fut reçu du premier coup. « La récompense de la philosophie, c’est la philosophie elle-même ! » écrivit-il, en forme de pied de nez à ses chers parents, comme à son professeur qui avait eu l’imprudence de noter sur son carnet scolaire, en guise de reproche : « élève trop vivant ! »
Et c’est cette proposition détournée qui m’est venue à l’esprit quand nous avons reçu la « bonne nouvelle » qui récompensait d’une mention honorifique notre travail éditorial commencé par hasard il y a 32 années maintenant, en même temps que cette autre anecdote que rapporte le philosophe et penseur politique Mario Tronti, quand, au début des années soixante, il se rendait avec d’autres militants opéraïstes aux grilles de l’usine Fiat de Rivalta pour distribuer des tracts théorisant la fusion entre intellectuels et ouvriers et que ces mêmes ouvriers, en prenant les feuilles de papier, lui disaient en souriant : « c’est quoi ? c’est du pognon ? »
Récompense sans pognon, donc, qu’il me faut partager, bien sûr, et tout d’abord avec Patricia Farazzi, sans qui ce fragile édifice n’aurait pu se construire et auquel elle a contribué plus que quiconque par ses livres et ses traductions et ses conseils et sa manière de ne jamais vouloir paraître, ce qui explique son absence ici ce soir. Et la partager aussi, bien entendu avec la « ribambelle » des auteurs, traductrices et traducteurs, pré- et postfacières et postfaciers, et tout celles et ceux qui, comme disent les Italiens, curano, « prennent soin de » ou « guérisent » ces « fameux livres » dont le poids s’accroît à mesure que nos épaules se font moins solides pour les porter.
Bien peu sont présents ici ce soir, où est rassemblée pourtant la fine fleur de la philosophie française. Probablement aussi parce que le catalogue s’est constitué surtout avec ses herbes folles, que nous sommes allés cueillir au gré de nos rencontres et de nos lectures ou qui sont venues à nous, portées par quelque vent sauvage.
C’est sans doute notre vocation que de suivre les chemins écartés d’une discipline à laquelle nous ne nous sommes formés qu’à la volée. Et à défaut de formation philosophique c’est plus un souci de et pour la philosophie qui nous a fait rassembler ces quelques livres autour d’une idée de catalogue, dont la première collection s’intitule « philosophie imaginaire », à la manière de ces « vies imaginaires » de Marcel Schwob, à la vérité desquelles on ne parvient qu’en faisant le détour par la liberté de ce qui s’invente. Souci de cette liberté qui serait antérieure à la vérité, comme la rédemption a été créée avant le péché dans le judaïsme, et dont le prix à payer aura été, sur plus de trois décennies, la très grande fragilité de l’édifice. Fragiles comme l’ont été nos auteurs emblématiques, rencontrés au hasard des lectures, des librairies, des bibliothèques ou des notes de bas de pages, à commencer peut-être par le philosophe italien Carlo Michelstaedter, dont il n’a pas été question ici pendant ces deux journées pourtant consacrées aux vertus et vertiges de la « conversation », et dont l’œuvre, concentrée en un seul ouvrage duquel nous sommes « inséparables », s’ouvre par ces mots : « Io lo so che parlo perché parlo ma che non persuaderò nessuno » : « moi je sais que je parle parce que je parle mais que je ne persuaderai personne ». Et il ajoute : « et c’est une malhonnêteté, mais la rhétorique anankazei me tauta drân bía : me contraint par la force à faire cela. »
Reste alors à celui qui veut continuer de converser, à se débrouiller avec cette malhonnêteté et à livrer « une guerre aux mots avec les mots », au risque de la vie même, jusqu’à ce que sa « lampe s’éteigne par trop d’huile », ou que « son âme soit assemblée à l’assemblée des vivants » selon la formule de Samuel que rappelle Patricia Farazzi dans le beau texte, Un crime parfait, qu’elle consacre précisément à Michelstaedter.
Fragile aussi comme l’équilibre qui veut rassembler dans une même barque des philosophes, des écrivains, des utopistes, des mystiques, des poètes, des musiciens, « femmes et hommes de la pensée », formant un entrecroisement de cercles qui seraient aussi « méditerranéens », au sens où c’est là, écrit Giorgio Colli – autre figure tutélaire du catalogue – que « la raison s’embrasa jusqu’à l’incandescence … et prit le nom de philosophie ». Cercles dont les centres, à Athènes et à Jérusalem, si distants l’un de l’autre, tout à coup se juxtaposent quand ce même Giorgio Colli, déplace en amont le point d’origine de la sophia pour l’ancrer non plus chez Thalès de Milet ou quelque autre « physiologue », mais au cœur même de l’enthousiasme, de la possession par le Dieu, de la possession par Dionysos. « Pourquoi commencer le discours sur la sagesse à partir de Dionysos ? écrit Colli. En fait, avec Dionysos, la vie apparaît comme sagesse, tout en restant vie frémissante : là est le secret. En Grèce un dieu naît d’un regard exaltant sur la vie, sur un fragment de vie, que l’on veut arrêter. Et cela est déjà connaissance. Mais Dionysos naît d’un regard qui embrasse toute la vie : comment peut-on embrasser d’un regard toute la vie ? C’est là l’outrecuidance du connaître. » Et le sage outrecuidant devient alors pro-phétès, à l’instar d’un Jérémie ou d’Ishaia, porteur de la parole enthousiaste, véhiculée par l’énigme, et dont l’éclat s’atténuera quand il s’agira de la mettre par écrit quand elle sortira de l’enclos sacré de la sophia pour devenir philo-sophia. « Désormais nous avons le livre, écrit Colli, et nous ne pouvons nous servir que de ce ‘succédané’. » Puis il précise : « Et nous devons justement nous en servir de façon à ce qu’il ne soit pas autre chose qu’un succédané ». Editeur de succédanés, donc, dont la tâche consiste à rappeler par le livre le caractère irremplaçable de la parole vivante.