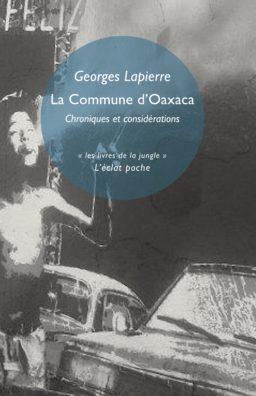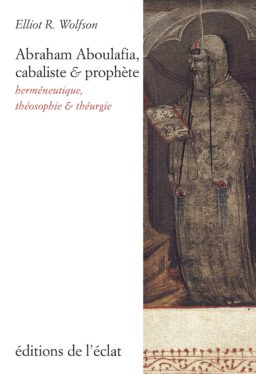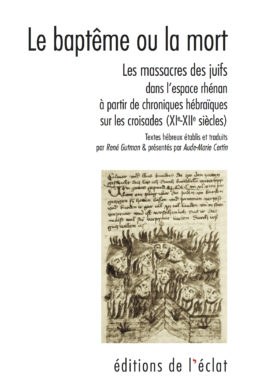La question du ‘populisme’ hante la politique italienne (et européenne) depuis – et c’est l’analyse de Mario Tronti – « qu’il n’y a plus de peuple ». À quel moment ce concept-réalité s’est-il désagrégé et se peut-il qu’il se réagrège dans une société où la classe est devenue une catégorie sociologique ? « Je n’ai jamais plus oublié la leçon de vie apprise aux grilles des usines, quand nous débarquions avec nos tracts prétentieux qui invitaient à la lutte générale anticapitaliste, et la réponse, toujours la même, des mains de ceux qui prenaient ces bouts de papier et disaient en riant: “c’est quoi? c’est du pognon?” Telle était la “rude race païenne”», écrit Mario Tronti dans Nous opéraïstes. Le ‘roman de formation’ des années soixante en Italie, Paris, Éditions de l’éclat, 2013, p. 24. « Peuple », parce qu’il y eut un ‘peuple communiste’, dont l’Italie a témoigné, peut-être plus durablement qu’ailleurs en Europe, et dont la voix de Mario Tronti témoigne à son tour. Issu des milieux populaires romains, il sera l’une des figures les plus importantes de l’opéraïsme italien, au sein duquel s’est forgé ce style « scandé, ciselé, combatif, constant, agressif et lucide » dont il est l’héritier et qui donne à ses écrits une dimension quasi unique dans la prose politique du XXe-XXIe siècle. Ce texte est une contribution à une discussion sur la question du « populisme » organisée par le Centro per la Riforma dello Stato. L’original italien a été publié dans la revue Democrazia e diritto, n° 3-4/2010. Il est disponible sur le site www.controlacrisi.org
La version française a été publiée dans la revue Lignes, n° 41 «Ce qu’il reste de la politique» (voir le sommaire), à l’invitation de Michel Surya. Il reparaît à la suite de La sagesse de la lutte de Mario Tronti
«Il est une foule de mots qu’on emploie tous les jours, que par conséquent on croit comprendre dans toute leur étendue, et que, cependant, peu de personnes privilégiées comprennent à fond. Tel est le mot cercle, tel le mot carré, dont tout le monde se sert et dont les géomètres seuls ont une idée claire et distincte : tel est encore le mot Peuple, que nombre de bouches prononcent, sans que l’esprit en saisisse la véritable signification. » Ainsi s’exprimait le mathématicien et philosophe Frédéric de Castillon, qui participait au concours de l’Académie royale de Prusse (1780), qu’il remporta d’ailleurs, sur la question, chère à Frédéric II, de savoir « S’il est utile au Peuple d’être trompé, foit qu’on l’induife dans de nouvelles erreurs, ou qu’on l’entretienne dans celles où il eft ?». « Ordinairement on entend en général par Peuple – écrit encore Castillon – le gros de la Nation qui, occupé presque sans relâche à des travaux mécaniques, grossiers et pénibles, n’a aucune part au gouvernement et aux emplois.» Nous sommes à la veille de la Révolution française, mais en Allemagne, où nation et peuple ne s’étaient pas encore rencontrés, comme ç’avait été le cas, depuis longtemps déjà, à travers les monarchies absolues, en Angleterre, en France et en Espagne. Nous sommes aussi donc en Italie et Frédéric de Castillon arrive à Berlin en provenance de Toscane. Nation et peuple naissent ensemble à l’époque moderne. Et c’est l’État moderne qui les ‘rassemble’. Il n’y a pas de nation sans État. Mais sans État, pas non plus de peuple. C’est important, d’un côté pour comprendre, de l’autre pour rapprocher le problème de l’époque qui nous concerne et nous implique. Parce que le thème est éternel. Biblique, avant même qu’historique.
Le concept vétéro-testamentaire de peuple — le peuple fondé par Moïse – me semble plus proche du concept moderne de peuple que ne l’est le démos des Grecs ou le populus des Romains. Ni la Cité-état, ni l’Empire, ne fondent un peuple. Pas de terre promise, pas d’exil, pas d’exode, pas plus que de Dieu des Armées! Les libres citoyens dans l’agora, comme la plèbe sur les gradins du Colisée, ne font pas un peuple. Autant d’images et de métaphores, actuelles/inactuelles pour notre temps. « Peuple » est un concept théologique sécularisé. L’assemblée des électeurs souverains, ou la belua multorum capitum [« le monstre à plusieurs têtes »] n’ont rien à y voir. Le peuple de Dieu vient avant le peuple de la Nation. Dans l’Encyclopédie de la pensée politique (Roma-Bari, Laterza, 2005), Roberto Esposito et Carlo Galli disent que le processus de sécularisation commence avec Marsile de Padoue (1275-1342) (universitas civium seu populus) et Bartolo da Sassoferrato (1314-1357) (populus unius civitatis). Mais ce sera Machiavel (1469-1527) qui parlera ensuite d’un gouvernement populaire distinct et opposé au principat et à la république aristocratique. Et pour Hobbes (1588-1619), « les sujets sont la multitude et le peuple est le roi » dans l’État du Léviathan.
Kings or the people. Power and the Mandate to Rule (1978), la puissante fresque de Reinhard Bendix, nous raconte le passage de l’autorité médiévale des rois au mandat moderne du peuple. «Mandate to rule » : combien de fois la modernité du capitalisme a fait, et n’a pas tenu, cette promesse, qui n’a servi finalement et toujours que ses propres intérêts, de développement, de changement, et, à travers les guerres et les crises, de renaissance ? L’histoire du XXe siècle, dans les différents passages – et retours – des totalitarismes aux démocraties, a confirmé tout cela. Et au moment où j’écris, quelque chose du même genre est en train de se produire sur les rives de la Méditerranée, dans l’écroulement des ‘sultanats’ sous la pression du peuple rassemblé sur les places. Mais vers où iront ces formes de peuple ? Qu’obtiendront-elles ? Qui serviront-elles ? Bendix raconte précisément la grande vague déferlante qui de l’Angleterre et la France du XVIe siècle n’arrive en Allemagne, au Japon et en Russie qu’au XIXe siècle, et atteint les rives du XXe avec la Révolution chinoise et le nationalisme (et socialisme) arabe. C’est une idée de peuple tout entière liée à la construction d’une Nation. C’est une idée bourgeoise, nationale et bourgeoise, de peuple. Mais au contraire de ce qu’on pensera dans la pensée progressiste, qui a fait tant de mal à la pratique du mouvement ouvrier, le concept politique de peuple n’explose pas avec la Révolution française, pas plus qu’avec les précédentes révolutions bourgeoises de même type, celle anglaise et celle américaine, qui sont des formes de guerre nationales et sociales. Il faudra attendre 1848 pour voir ce nouveau sujet politique à l’œuvre. Delacroix, tout imprégné de l’idée romantique de Volksgeist, était parvenu à apercevoir dans la Révolution de Juillet 1830, l’image triomphante de la « Liberté guidant le peuple ».
Mais c’est le « Maudit soit juin1 » de 48 qui, de Paris à l’Europe, verra la réalité, impensable pour les bourgeois, du peuple en armes sur les barricades, pour sa propre révolution. Marx commit l’erreur géniale d’y entrevoir prophétiquement la figure émergente du sujet politique ouvrier. Il s’agissait en réalité de l’ancien prolétariat qui, depuis la première révolution industrielle, avait déjà envahi des pans entiers de la société, surtout urbaine. Mais c’est là un point déterminant, d’analyse, et d’orientation, et de jugement. C’est le concept de classe qui fait du peuple une catégorie de la politique – de la politique qui nous intéresse, celle autonome par rapport à l’usage qu’en ont fait et qu’en font les forces dominantes.
Le concept de classe, et de lutte de classe, surgit dans l’histoire moderne pour déstabiliser tout l’appareil théorique d’analyse de l’économie et de la société. Il avait été inventé par les historiens de la Restauration. Les réactionnaires ont toujours un regard très acéré, pour leur propre intérêt de caste, dans leur lecture de la réalité effective. Avec la classe, le peuple devient sujet politique. Dès lors se déploie une histoire ambiguë, double, nullement linéaire, en ombre et lumière, en fulgurances de clarté et périodes de confusion. C’est le point de vue de classe qui fait du peuple un sujet politique. Sans classe, il n’y a pas, politiquement, de peuple. Il n’est que socialement. Ou nationalement. Qui sont deux formes de neutralisation et de dépolitisation du concept de peuple.
L’expression « peuple communiste » fut âprement contestée par les théoriciens (et par les praticiens) du national-populaire. À juste titre, du point de vue, respectable, de continuité gramscienne-togliattienne qui était le leur. Mais « peuple communiste » avait un sens dans le parti, et pour le parti, qui se disait « parti de la classe ouvrière ». Quand cette dénomination a été abandonnée, déjà quelques années avant le démantèlement du PCI, pratiquement juste après Berlinguer, ce n’est pas seulement le peuple communiste qui s’est éteint, mais le concept-réalité, politique, de peuple. Nous devons savoir que quand nous parlons aujourd’hui de « couches populaires », nous utilisons un concept sociologique, une condition, une imposition, de présence sociale, qui est précisément imprenable, irreprésentable politiquement, et ce n’est pas un hasard. De fait, il ne peut être repris, et représenté que par des positions anti-politiques. Le populisme est au cœur de ce nœud de problèmes. Que signifie le fait que populism et narodnicestvo veuillent dire, plus ou moins à la même période – des dernières décennies du XIXe siècle –, et même sous des formes si différentes, la même chose, et expriment en tout cas la même orientation? Qu’est-ce que cela signifie sinon la confirmation de la prévision tocquevillienne selon laquelle l’Amérique et la Russie seraient les grands protagonistes historiques du XXe siècle ? C’est à partir de la crise du populisme que naît l’âge mûr de la démocratie en Amérique. C’est de la critique du populisme que naît la théorie et la pratique de la révolution en Russie. Cette dernière chose nous concerne de manière très particulière. Le jeune Lénine qui combat contre les « amis du peuple », en bon social-démocrate, gagne, sur ce terrain, l’analyse correcte du développement du capitalisme dans un pays sous-développé. La méthode est juste. Le populisme a toujours indiqué un problème. Et un problème réel. Aujourd’hui encore, à partir de cette indication il faut remonter à la nécessité d’une analyse des conditions réelles, sociales et politiques, économiques et institutionnelles, dans lesquelles nous nous trouvons.
De la critique aux solutions qu’avance le populisme, il faut revenir à l’élaboration de solutions alternatives. Le populisme est la forme – une des formes –, sous laquelle se repropose périodiquement le problème non résolu de la modernité politique, à savoir le rapport entre gouvernants et gouvernés. En ce sens, le phénomène a passé le seuil des sociétés les moins avancées, où prévalent les économies rurales et de masses paysannes, comme ce put être le cas, et ne l’est plus désormais, dans certains pays d’Amérique latine. Il a atteint ensuite, sous des formes inédites, les économies qui se disent post-industrielles, et les systèmes politiques qui se disent post-démocratiques. C’est là qu’il nous faut porter notre regard plus en profondeur. Comme tente de le faire ce numéro de Democrazia e diritto .
Quand a été présenté au Centre de la Réforme de l’État, le livre d’Ernesto Laclau, La ragione populista (Bari, Laterza, 2008), nous avons apprécié son effort pour faire la critique du populisme tout en essayant de sauver l’idée de peuple. C’était la bonne démarche. L’anomalie italienne le démontre parfaitement, celle d’hier comme celle d’aujourd’hui. Celle d’hier voyait des grandes forces politiques solidement appuyées sur des composantes populaires présentes dans l’histoire sociale, le popularisme catholique, la tradition socialiste, la diversité communiste. Dans la mesure où il y avait un peuple, il n’y avait pas de populisme. À la différence d’aujourd’hui où nous avons du populisme parce qu’il n’y a plus de peuple. Il n’est pas inutile ici précisément, presque même indispensable, de revenir au concept politique de peuple. Parce que c’est de ça qu’il s’agit. Comment et quand s’est dissous ce que nous avons appelé un concept-réalité ? C’est arrivé en même temps et dans le même contexte que la dissolution de l’idée et de la pratique de classe. Et non pas parce que la condition sociale de classe a disparu, mais parce qu’on a cessé de s’y référer politiquement. Cet espace laissé vide a été rempli par la pulsion populiste actuelle, qui ne prend plus sa source dans une sorte de rappel défensif à des anciennes traditions communautaires, mais plutôt, au contraire, dans l’adaptation agressive à la décomposition de tout lien social.
Lénine appréciait le premier populisme russe et pas le second. Comme nous devrions à notre tour apprécier le populisme de la People’s Party, et pas celui de la Tea Party. Peut-être convient-il de relire Christopher Lasch, comme le conseille justement Claudio Giunta dans le numéro 4/2010 de Italianieuropei consacré au populisme. Lire, naturellement, avec mesure, ce que Lasch lui-même écrit dans le court texte publié dans ce numéro : « La gauche a perdu depuis bien longtemps tout intérêt pour les classes inférieures. Elle est allergique à tout ce qui ressemble à une cause perdue. » Une cause perdue c’est s’occuper encore, comme naguère, des problèmes quotidiens des habitants des périphéries des grandes métropoles, qui ont pris la très mauvaise habitude de ne jamais fréquenter l’Auditorium de la Cité de la Musique.
Il n’est pas facile de dire, aujourd’hui, ce qu’est le peuple. Le peuple du turbocapitalisme : composition sociale, implantation territoriale, héritages traditionnels, langue, dialecte, culture, entre mégalopoles, centre de petite ou moyenne dimension, village et fraction de village, différence féminine, ici, à ce endroit-là, dans le bas de l’échelle sociale. Espaces d’analyse pour une gauche du futur. Ce n’est pas en surfant sur la Toile que l’on peut toucher les niveaux les plus bas de l’existence humaine défavorisée. Ce n’est pas avec la biopolitique que l’on saisit les besoins des personnes simples, des femmes et des hommes que l’on dit « de chair et d’os ». Rien n’est plus comme avant, rien ne peut plus être dit comme avant, récite le Mantra. Mais je ne trouve pas de définition de peuple qui soit différente de « classes inférieures ». Différente de l’idée dix-huitième siècle d’une population « occupé[e] presque sans relâche à des travaux mécaniques, grossiers et pénibles, [et qui] n’a aucune part au gouvernement et aux emplois ». Constitue-t-elle encore, une majorité ? Cela dépend du point de vue d’où on regarde le monde : de l’Occident ou de l’Orient, du Nord ou du Sud. Ici, chez nous, dans notre petit jardin enchanté et si mal en point, la contradiction est toujours plus grande. Que ce soit avec la crise ou avec la croissance, la distance entre les riches et les pauvres s’est encore accrue au cours des dernières décennies. Celui qui travaille, travaille plus et gagne moins. Celui qui ne travaille pas parce qu’il ne trouve pas de travail, descend les échelons de l’échelle sociale : comme ce qui arrive désormais, et pour la première fois, à cette forme inédite de sous-prolétariat intellectuel. Est en acte une sorte de prolétarisation postmoderne des couches moyennes. Sociologiquement ce que l’on peut considérer comme peuple se reproduit sous une forme élargie. Mais cette mesure quantitative n’est pas le point décisif. Même si les classes inférieures étaient destinées à constituer une minorité consistante, c’est de ce côté-là qu’il faudra être.
Il n’y a qu’un seul moyen de combattre efficacement le populisme d’aujourd’hui, jusqu’à en défaire les raisons, c’est de donner un signe politique à cette réalité de peuple. Gino Germani analysait de manière perspicace le populisme comme le passage de la tradition à la modernité, où des morceaux de l’une cohabitaient aves des morceaux de l’autre et entraient en conflit. Il évoquait surtout l’Amérique Latine. Mais le discours vaut aussi pour le populisme des origines, russe et américain. Le populisme d’aujourd’hui décrit le passage du moderne à ce qu’on appelle le postmoderne, pour désigner une chose dont personne ne sait précisément ce qu’elle est, une terre de personne, mais pour ce que l’on peut déjà voir, une monde sans âmes, de corps seulement, mais virtuels, corps sans chair, appendices des machines, les seules créatures restées dotées d’intelligence. La dérive populiste, maladie sénile des sociétés avancées, exprime essentiellement tout cela dans son fonds obscur. La forme politico-institutionnelle – et il serait plus correct de dire anti-politico-institutionnelle – est le nouveau Léviathan de la démocratie populiste. Un monstre nullement inoffensif, armé de cette violence subtile qu’est le consensus plébiscitaire, macroanthropos animalisé, revêtu des brillants atours du participatif, qui cachent la vie nue de la cession de souveraineté de la nouvelle plèbe au chef ultime, pas même charismatique. Dans le populisme d’aujourd’hui, il n’y a ni peuple ni prince. Et ce que nous avons appris à l’école – « pour bien connaître la nature des peuples il faut être prince, et pour bien connaître la nature des princes, il faut être populaire » – a besoin, pour être à nouveau mis à profit, que ré-émergent, dans leurs nouveaux atours, les pôles du conflit. C’est pourquoi il est nécessaire de battre le populisme, dans la forme de la démocratie populiste ; parce qu’il cache le rapport de pouvoir. C’est l’appareil idéologique, adapté à notre temps, qui masque et en même temps garantit, le fonctionnement de la réalité. Il y a tout dedans : la dictature de la communication, l’ancienne société du spectacle toujours recommencée, la civilisation du loisir, la dernière rhétorique de masse, la rhétorique de la toile, l’interactivité comme lieu du subalterne. Conséquence : tous, et toutes, parlent de politique de manière extravagante, sans regarder les montagnes depuis les plaines, ni les plaines depuis les montagnes, mais tournant autour, bavardant du plus et du moins, de corps et de désirs, de commun et de gouvernance, de droits et tumultes.
Comme se fait un peuple aujourd’hui : telle est la question. Comment se fait un peuple sans la centralité de classe désormais. Faire un peuple est aussi difficile que de faire une société. Est-il possible de réagréger une subjectivité collective de personnes après la désagrégation que les esprits animaux bourgeois ont produit dans les rapports absolument asociaux entre les individus ? Et aussi : comment se fait un prince désormais sans la souveraineté de l’État-nation ? Quelle autorité sans État, et toutefois encore en présence du pouvoir ? Qui décide de l’état de normalité, dès lors que l’état d’exception se place désormais en dehors de l’Occident ? Laclau s’est référé plusieurs fois aux études de Margaret Canovan, à la fois aux plus récentes où elle reprend la distinction de Michael Oakeshott entre une politique rédemptrice et une politique pragmatique, qu’aux plus anciennes (Populism date de 1981) où justement, dans le populisme urbain, différent du populisme rural des origines, se repropose le problème du rapport entre les élites et le peuple. Le thème du sens de la politique et le thème de la verticalité de la relation politique sont étroitement imbriqués. Tour à tour, par tout temps, et pas nécessairement à chaque époque, — les époques sont rares ! – le premier thème reste identique dans l’éternel retour, et le second change de forme dans le cours de l’histoire.
En maintenant ensemble une politique de rédemption et une politique de réalisme, tu dois comprendre ce qu’il y a, ici et maintenant, dans le bas de la société et dans les hauteurs du pouvoir. Le XXe siècle t’a donné le peuple comme classe et l’élite comme parti. Une simplification puissante qui a fait une grande histoire. Compréhensible pour tous, elle a mis les masses en mouvement. Modèle qui ne se répètera pas? Il est probablement que oui. Parce que le système des sujets est dépassé. Mais dépasser – celle-là oui, une époque ! – dialectiquement veut dire en conserver l’essence de méthode, le mouvement de la politique. Peuple et élite ne mènent pas au populisme. Ce qui mène au populisme c’est un chef et une élite. La théorie des élites a anticipéune critique de la personnalité autoritaire. Et elle l’aurait conjurée si elle avait été pratiquée par une grande force politique. À travers la reproposition de la théorie des élites on pourrait aujourd’hui faire une critique à postériori de la personnalité démocratique. Et on pourrait délégitimer celle-ci dans la pratique d’un mouvement politique fort.
Il n’y a qu’une seule manière de déconstruire le pouvoir de la personnalisation, c’est reconstruire l’autorité des classes dirigeantes. Cela ne peut se faire qu’à gauche et qu’avec la gauche. Ce n’est que de cette manière que l’on peut ressusciter, par l’esprit, le sens authentique du concept politique de peuple : en le spécifiant et en le déterminant avec le concept social de travail. Peuple, non de sujets soumis, ni de citoyens, mais de travailleurs. Peuple travailleur : un tout nouveau mot ancien. Où le fait de travailler atteint non pas la vie, mais l’existence, dans la centralité politique de la personne qui travaille. Pour retrouver ce sens après la juste, et libre, partialité ouvrière – où justice et liberté ont vraiment eu un sens – il faut, et il est possible de – peut-être pour la première fois – fonder une classe générale. Celle du peuple travailleur. La classe ouvrière, dans son orgueilleuse revendication d’être partie, dans son refus du travail, qui n’était rien d’autre que le refus d’être classe générale, a été un sujet révolutionnaire vaincu. Pour que la défaite politique ne se traduise pas en fin de l’histoire, il faut se ressaisir du fil là où il a été rompu, en refaire le nœud et repartir et aller de l’avant. L’issue est totus politicus. Peuple travailleur comme classe générale n’est possible qu’aujourd’hui, dans les conditions du travail étendu et parcellisé, diffus et morcelé, territorialisé et globalisé, travail marxien sans phrase, qui va de la besogne des mains à la besogne du concept, de l’emploi que l’on aime pas à l’emploi que l’on ne trouve pas, archipel d’îles qui font un continent. Qu’est-ce que l’élite ? C’est la force politique qui fait des travailleurs un peuple. Une classe dirigeante qui ne fait pas d’elle-même, mais du travail, un sujet gouvernant. Après on trouvera le nom du but final. Pour le moment indiquons les moyens pour l’atteindre.
NOTES
. On trouvera le sommaire de ce numéro à la page : http://www.centroriformastato.org/crs2/spip.php?article299
. C’est le titre d’un chapitre d’Ouvriers et capital, le livre classique de Mario Tronti : « Pour nous, écrit Tronti, c’est seulement en 48 – ou plutôt après juin 48 – que se produit, pour la première fois, dans la pensée de Marx, la rencontre du concept de force de travail avec les mouvements de la classe ouvrière. C’est dès lors que commence la véritable histoire marxienne de la marchandise force de travail, qui, réapparaîtra, avec tous ses “ caractères particuliers ”, c’est-à-dire son contenu spécifiquement ouvrier, mais cette fois-ci en termes explicitement définis, dans la Contribution à la Critique de l’Économie politique et plus tard dans le Capital. En ce sens, les bourgeois d’alors avaient bien raison de se lamenter, bien qu’ils aient battu les ouvriers sur le terrain, en disant : “ Maudit soit Juin ! ”»