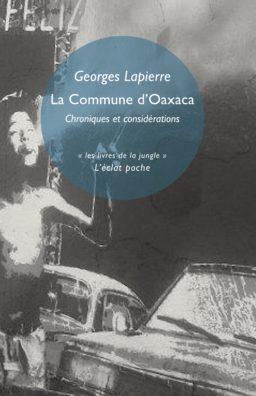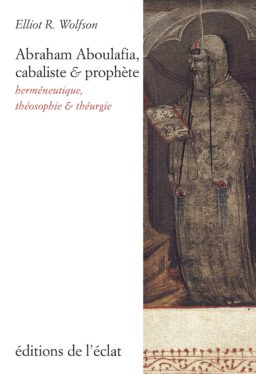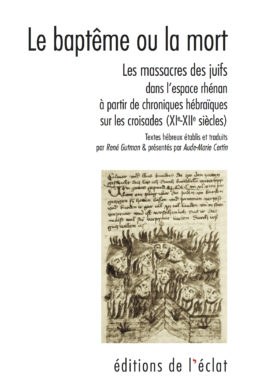Premier épisode : Postérité programmée
Premier épisode : Postérité programmée
Il semble que l’on assiste à une production désormais industrielle de ‘classiques’. Au lent et sûr sédiment du temps se substituent des machines calibrantes, soumettant aux algorithmes marchands et aux intérêts privés des pages d’écritures qui, au lieu de finir dans les poubelles de l’histoire littéraire d’où elles n’auraient jamais dû sortir, sont hissées au rang de chef-d’œuvre sur papier bible, pour étayer la thèse d’un nouveau classique en devenir.
La fabrication de ces « classique en cours », qui consiste à embaumer quelques vivants bien choisis et répondant à tous les critères d’une postérité adaptée aux besoins de la ‘boutique’, est aujourd’hui florissante. Les étoiles des pléiades nouvelles ne scintillent plus qu’au prix d’une exorbitante facture d’électricité, passée en frais généraux de la postérité factice. La charité suggère de ne pas donner de noms, mais ils s’étalent déjà suffisamment partout et n’importe où, pour nous épargner la désolation de les redire encore.
On se souviendra peut-être d’une vignette du caricaturiste italien Altan qui, à l’occasion de l’exposition controversée des aquarelles d’Hitler à Florence, avait dessiné un enfant qui demandait à son père pourquoi les spécialistes d’histoire de l’art avaient mis tant de temps à découvrir l’existence de ces aquarelles ; et le père lui répondait : « Parce que jusqu’à présent, les spécialistes d’histoire de l’art utilisaient uniquement des rouleaux de papier-toilette Scottex® ».
Le cas de Céline et de ses chefs-d’œuvre controuvés et miraculeusement retrouvés, évoque cette « vignette » d’un autre temps. Il n’empêche que, comme un seul homme (ou presque – et surtout les hommes semble-t-il), nos faiseurs de classiques se pâment et se repâment à longueur de colonnes devant ce qui n’est rien d’autre qu’une énième resucée d’une œuvre anecdotique pour adolescents tardifs, frissonnant à l’énoncé de quelque grossièreté rebattue, que leurs papas-et-mamans tutélaires avaient bannie du vocabulaire de leurs salons bourgeois et dont le vingtième siècle aurait largement fait l’économie, comme des ignominies de son auteur et de l’infini ennui de ses pages.
Si l’on veut avoir une idée de la Grande Guerre, que l’on jette un œil sur Témoins de Jean Norton Cru, dont une nouvelle édition intégrale paraît en même temps que ces libelles et dont personne, à notre connaissance, n’a même signalé l’existence.
À l’occasion d’un ouvrage sur la confusion qui finalement n’a pu se faire, nous avions commencé d’écrire une lettre sur le Classique, qui est donnée ici à lire dans le second épisode, ne serait-ce que pour évoquer quelques écartés de la langue qui accompagnent depuis plusieurs dizaines d’années le travail des Éditions de l’éclat et dont la machine littéraire sus-citée s’est bien peu inquiétée. Qu’importe ! Nous dépasserons les non-événements !
Second épisode : Voyage autour d’un catalogue en chambre
Nous avons attendu pendant cinq mois un livre de Fondane, dans cette vieille édition Plasma, assez fautive, mais émouvante parce qu’elle évoque aussi la silhouette de l’éditeur, Pierre Drachline, toujours dégingandée avec son bon mètre quatre-vingt et une sorte de sourire à la fois amical et toujours un peu désorienté dans ce monde de l’édition, guindé et propre sur lui, dans lequel il était quand même parvenu à trouver une place, même s’il détonnait évidemment des pieds jusqu’à la tête.
Il semble qu’on ne détonne plus guère aujourd’hui et que les choses sont désormais rivées à leur tonalité uniforme, sans la moindre chance de les voir se mêler à d’autres, qui leur seraient étrangères ou contradictoires. Paradoxalement, c’est peut-être cela la confusion : que les choses ne puissent plus se confondre, s’emmêler jusqu’à se fondre dans un même et plus riche mélange hétéroclite et finalement harmonieux de contraires. Au lieu de ça, « ici c’est rouge, là c’est jaune, ici c’est bleu », comme dans cette blague d’un guide qui trimballe au pas de course une classe de gamins dissipés dans un musée où les tableaux sont rangés par « couleur fondamentale », et où aucun mélange n’est désormais permis.
En littérature, on assiste à peu près à la même chose, « ici c’est papa et maman, là c’est pépé et mémé, ici et là c’est moi et moi et moi… », et on la voit se ratatiner à vue d’œil, sous les acclamations de la foule ébaubie et bernée.
Dans tout ce fatras, on s’est demandé ce que pouvait être aujourd’hui et à quoi pouvait-on désormais reconnaître un classique.
Glissant hors de la boîte à outils du temps infini, « avant que ne se dressent les cordillères des temps historiques » (Zambrano), le classique devrait a priori être, par tous les temps, à venir. Invisible dans l’aujourd’hui, il ne marque pas son temps, et même le plus souvent il n’est pas reconnu par son temps, qui lui préfère la nouveauté consommable. Le classique n’est jamais nouveauté, ou alors il est à jamais nouveau, parce qu’il se déplace le plus souvent avec l’extrême lenteur de l’Immortel, qui a, littéralement, le temps, et apparaît, tremblant comme un mirage, jusqu’à ce que sa silhouette s’inscrive plus distinctement dans le paysage et qu’on le reconnaisse. Il est cet inconsommable dont Jean-Clet Martin a fait, il n’y a pas si longtemps, l’éloge et l’inventaire dans la vie quotidienne.
Dans un livre collectif sur la défense de l’étude du grec et latin, retrouvé dans un coin de l’ordre compliqué de la bibliothèque, est citée en exergue cette phrase de Mandelštam : « Le classique est ce qui, encore, doit être. » Mandelštam est sans doute optimiste à penser qu’il ‘doit’. Devrait ?pourrait ? Pourrait-il ne plus jamais devoir être ? Pourrait-il même, par les temps qui courent, ne plus jamais être seulement ? Dans le monde qui nous resterait encore, le classique est le temps qui ne passe pas, la boucle où s’enroule et se déroule ce qui tient lieu de la vie même, sans que jamais ne se pose la question de savoir ‘quand ça va finir’ ni ‘comment ça a commencé’. Et ça commence quand même par une phrase, la première qui nous saisit, ne nous lâche plus jusqu’à ce que nous en fassions un principe de vie, ce par quoi tout commencera toujours et jamais ne finira tant que nous durerons.
« Moi je sais que je parle parce que je parle, mais que je ne persuaderai personne ; et c’est une malhonnêteté, mais la rhétorique me contraint à faire cela malgré moi ou, en d’autres termes, si quelqu’un a mordu dans une sorbe perfide, il faut bien qu’il la recrache. »
Incipit vita eterna ! nous nous sommes demandés si et à quel moment La persuasion et la rhétorique de Carlo Michelstaedter deviendrait un classique. À quel moment il pourrait venir se ranger aux côtés de ces quelques livres sur lesquels, sans forcément y revenir souvent, le regard se pose, s’imprégnant de sa révolte intérieure, à partir des lettres sur leur dos effleuré de la main. Parce que le classique est toujours du côté des révolutions – celle des orbes célestes, « version alternative de l’Univers » dit le dictionnaire, et celle de l’imprévisible liberté du monde qui vient.
Et en nous demandant cela, nous nous sommes demandés si dans cette pitoyable confusion générale à laquelle nous sommes confrontés depuis quelque temps, sans que l’on sache précisément quand elle a commencé, ni ce qui l’a suscitée, ne se nichait pas la volonté d’empêcher que le classique advienne, pour favoriser plutôt la valse des vanités flasques, « tirées d’une histoire vraie », aussi ‘vraie’ que l’impression de déjà-vu de ce qui n’a jamais été. Déjà-vécu précaire. Nouveauté déjà ancienne.
Le commerce moderne du livre s’est satisfait largement de cette nouveauté-là, depuis que le fonds de librairie est devenu tréfonds et que des algorithmes établissent pour chaque code EAN désignant un livre, la fiche signalétique de sa ‘rotation’ qui détermine un seuil de rentabilité et condamne les livres peu lus pendant un laps de temps à être moins lus encore, pour disparaître finalement de l’étalage.
La formule de Diderot, qui définissait un « fonds de librairie » comme « la possession d’un nombre plus ou moins considérable de livres propres à différents états de la société, et assorti de manière que la vente aussi sûre mais lente des uns, compensée avec avantage par la vente aussi sûre mais plus rapide des autres, favorise l’accroissement de la première possession », n’a plus cours. En réduisant l’offre aux seuls livres rapides, on réduit les différents états de la société à une seule peau de chagrin, à un seul état indifférent généralisé – l’état de ‘fonds mort’ – qui conduit au pilon les quelques livres lents pour quelques lents lecteurs, et achève de normaliser cette même société, désormais algorithmée. Ainsi la possibilité d’un classique se réduit-elle à mesure qu’augmente la rapidité de circulation des ouvrages au détriment de la lente présence de ce qui échappe au temps.
Récemment, un de nos gros malins de l’édition a inventé le slogan « Lisez un classique, c’est moderne ! ». Mais à quoi sert un classique, qui ne serait jamais ‘moderne’ et donc, comme la tortue de Zénon, jamais ‘dépassé’ par l’Achille en jogging des services de communication ? La question est évidemment mal posée parce que le classique ne sert à rien, quand il surgit dans la vie comme une amitié soudaine, l’apparition d’un être cher, ou encore une phrase qui revient en mémoire, « Bergère ô tour Eiffel le troupeau des ponts … etc. », déployant, tout à coup, devant nos yeux, l’image d’une ville et d’un fleuve telle qu’on voudrait qu’ils soient, « un triple fleuve aux eaux noires… Le berceau d’encre où tous nous laissâmes quelques plumes … Une trilogie d’eau et d’asphalte qui berça nos enfances de troubles mystères » (Farazzi). Ou, dit autrement, le classique ne sert rien, parce qu’il contrevient au temps, ne se plie pas à la règle des conventions, fuit comme la peste le profitable et l’utile, qui produisent, à travers l’école, des armées dociles d’employés de la machine d’État. Le classique ne se résigne pas. D’où sa substitution par des « classiques programmés », prêts-à-lire.
Dans ce livre sur l’étude du grec et du latin, il y a également un texte de Massimo Cacciari qui cite Leopardi :
« C’est une curieuse évolution des études humaines, qui fait que les génies les plus sublimes, libres et irréguliers, quand ils ont acquis quelque notoriété établie et universelle, deviennent classiques, à savoir que leurs écrits s’introduisent au nombre des livres élémentaires, et sont mis dans les mains des enfants, comme les traités les plus arides et les plus réguliers des connaissances exactes ».
Et c’est pourquoi, poursuit Cacciari, « une authentique philologie … devrait en faire revivre toute la dangerosité ». C’est finalement assez normal que, dans les quatorze raisons qu’Italo Calvino donne pour dire qu’il faut lire les classiques, il n’envisage à aucun moment cet aspect : la force inquiète et émancipatrice, dangereuse, de sa lecture dans une actualité asphyxiante. Pris dans la combinatoire des récits, Calvino s’est visiblement accommodé du récit soumis de la combine.
Mais comment ça a commencé ?
« De ce début de siècle, nous avons encore le souvenir. De ses révoltes, de ses insoumissions, nous sommes nombreux à ne rien vouloir oublier. Nous savons pourtant que nous vivons dans un monde qui s’en emparera, nous en dépossédera afin que des enseignements n’en soient jamais tirés, et que rien de ce qui est advenu ne vienne repassionner les subversions à venir. » (Mauvaise troupe)
Ça ne date pas d’hier, mais il semble que le virus de la confusion soit venu subrepticement se loger au cœur même de la distinction, et, à la manière d’un parasite, s’en soit nourri pour en produire les métastases. Ou, pour adapter une phrase ancienne à une situation nouvelle :
« Les armes dont le mouvement révolutionnaire s’est servi pour abattre le capitalisme se sont retournées contre le mouvement révolutionnaire lui-même. »
Le désespoir confus auquel nous sommes confrontés prend naissance au cœur de l’espoir inédit du « premier vingtième siècle », comme son « jumeau évanescent », pour en saper les formes et les fondements et lui substituer l’égoïsme infiniment jaloux de l’espèce des vainqueurs. À le combattre, on combat du même coup l’espoir. C’est toute la complexité. C’est pourquoi il faut combattre le combat ou, comme l’écrivait Hermann Broch, « remporter la victoire sur la victoire ». C’est alors seulement que l’on peut rejoindre l’île des « invincibles », même si, on le sait depuis Giorgio Colli, « les invincibles, on les tue par le silence ».
Si on a pu dire jadis que « le silence est le bouclier de la sagesse », il semble qu’il soit devenu désormais l’arme de ceux qui ont la parole, quand ils se taisent sur ce qui devrait être dit, quand ils effacent ce qui devrait être montré, quand ils s’emparent de la parole mesurée et du geste réfléchi pour les livrer à la meute. Et ce qui vaut pour l’écrit, vaut pour toute œuvre ou toute action créatrice, qu’elle soit écrite, peinte, jouée, chantée ou fomentée.
Michelstaedter l’avait formulé autrement :
« Avec les mots, guerre aux mots
comme le souffle vif dissipe les brumes
pour que brille le soleil –
mais de sa valeur ne tire avantage. »
Quelle forme, alors, peut prendre cette guerre, pour que le souffle vif ne subisse pas le même sort que les brumes, quand brille le soleil ? Pour que l’espérance partagée ne meure pas avec le combat contre « l’égoïsme infiniment jaloux de l’espèce des vainqueurs » ? La forme de l’« irrésignation » (Fondane), qui est forme de révolte, est aussi forme de retournement, de retrait. Et c’est au « retour comme progrès » (Strauss), à la retraite comme avancée, à la révolution dans tous les sens du terme, qu’aspirent celles et ceux qui s’attachent à faire vivre leur souffle vif en quelque lieu que ce soit. C’est depuis le secret des « hautes et fines enclaves » du présent-qui-ne-passe-pas que se construisent les mondes.
Les habitants de Roanoke, qui abandonnèrent la première colonie anglaise du Nouveau Monde (1580) pour rejoindre dans la jungle les tribus indiennes, avaient laissé comme seul message à l’occident conquistador : « Partis pour Croatan » (Hakim Bey). On ne les a jamais retrouvés, ni leurs tombes. Sont-ils encore vivants ? Où est Croatan ? Nulle carte n’en indique la position ? Serait-ce l’île des invincibles éternels qui ne sont pas victorieux ? Son territoire est mouvant, mais ses contours apparaissent discrètement sur des cartes récentes de certaines Contrées dans la géographie du nouveau siècle.
La zad de Notre-Dame-des-Landes, après les longs combats des années 60 et 70 jusqu’à la création de la zone à défendre en 2008 et depuis la guerre des bocages contre César en 2012 jusqu’au 17 janvier 2018, date de l’abandon du projet d’aéroport, s’est nourri de ce souffle vif pour dissiper la brume des lacrymogènes, et a fait couler beaucoup d’encre et de larmes pour que brille le soleil sur une histoire exemplaire du « rien de trop », inscrit à l’encre sympathique au fronton de la ferme des 100-Noms.
2022 : La zad est rentrée en elle-même, elle s’est retirée dans son propre Croatan pour inventer son monde. Elle a tiré avantage de s’être tue et regarde maintenant venir avec la plus grande discrétion.
C’est pourquoi on peut dire que la zad est et sera classique. Comme un vers de Dante, un poème d’Apollinaire ou un solo d’Alan ‘Blind Howl’ Wilson, elle s’inscrit au fil du temps dans l’histoire longue de ce « qui, encore, doit être ». Elle ne s’oublie pas, mais elle sait manier le ‘bouclier’ de la « sagesse de la lutte ».
Relèverait-elle alors d’une forme différente de « politique anarcho-mystique, qui livre mieux ses secrets en les taisant plutôt qu’en les énonçant », dont parle le pseudo-Scholem ? Ou applique-t-elle cet usage de la cagoule des zapatistes du Chiapas, qui, selon la tradition des Mayas qui vivaient sur leurs terres, pensent que « le masque cache une vérité pour en désigner l’existence » ? C’est pourquoi, raconte le poète Juan Gelman, un Indien du Yucatan, Librado Sánchez, a écrit un corrido pour le sous-commandant Marcos : « Le ban et l’arrière-ban veulent connaître ton visage / pour préparer la trahison. … N’enlève pas ton masque / garde-le, je t’en prie / qu’ils ne sachent pas qui tu es / ça vaudra bien mieux comme ça ».
Ca vaut encore bien mieux comme ça, et cette clandestinité désigne, dans la distance, l’existence d’une vérité sans dogme, sans temps. Vérité du classique qui peut aussi se retrouver devant soi, intact, surgissant de cette clandestinité, parce qu’il est appelé par une situation qui cherche sa résolution. Il devient tout à coup « ce passé qui est devant nous » (Le Guin). Notre tâche alors, comme il en avait été déjà question en 1957, est de « construire des situations » pour « faire partout reculer le malheur » (Debord).
Comment s’y prendre ? Probablement autrement qu’en 1957, et peut-être en faisant le pari que la situation, c’est la construction elle-même en train de se faire. Faire, sans penser au résultat, sans augurer du fait, toujours imparfait, qui est l’expression « du monde de l’apparence » (Colli), ou de ce qu’on a appelé à la même époque, mais dans un autre contexte, le ‘spectacle’. « Faire, non pas devenir, mais faire, et en faisant se faire » (Lequier). Peut-on faire ça aujourd’hui ? « Penser, décrire, légiférer et puis refuser d’obéir. Préférer douter et décliner d’acquiescer et d’obtempérer. Douter, comme pour se libérer. Pouvant et choisissant de douter, refuser de se laisser plier. » Philosophie infinitive (Fournier).
Coda
Au fil de ce second épisode, la longue ribambelle des citations, visibles ou invisibles, est l’occasion de parcourir un catalogue qui a grandi à l’ombre de quelques livres, sur lesquels on revient sans cesse et dans lesquels, chaque fois, se renouvellent les découvertes, à « les serrer, les presser, les épuiser, les tourmenter, les mettre en pièces et les remettre ensemble sans céder au charme de la polymathie » (Colli). Parce que nous nous sommes dits que c’est ainsi que l’œuvre prend de la hauteur, à la mesure de son approfondissement. Le classique est un puits profond dont le fond réfléchit le ciel. On se penche à son bord et on perçoit, chaque fois, l’oracle sonore des instants reflétés. Comme « poser l’oreille contre un coquillage, c’est se donner à entendre tout un océan » (Bonnet). On retrouvera au fur et à mesure des liens la liste hétérodoxe de quelques-uns de ces ‘classiques pour un temps’, grâce auxquels nous avons pu construire la barque et auxquels il nous faut déclarer notre dette. Vous les reconnaîtrez sous leurs masques. Ce sont de vieilles reconnaissances.
L’éclat